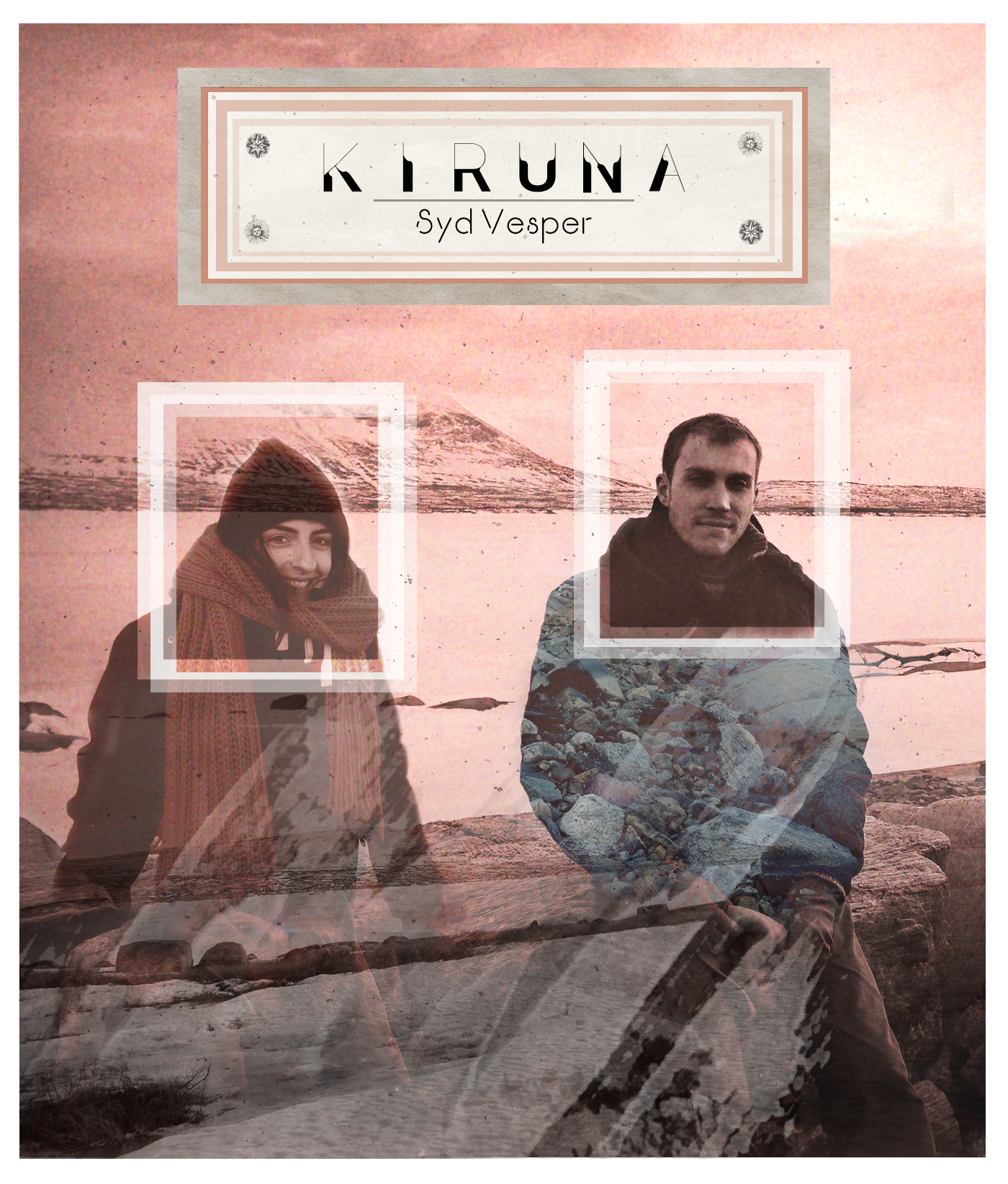
Vous pouvez lire l’histoire ici, sur WATTPAD, ou au format PDF ci-dessous :
KIRUNA
—————————————————————————————————————————————–
KIRUNA
par
Syd Vesper
(La nuit aux yeux vides)
Il existe une région solitaire, perdue au nord d’un pays retiré, le long du cercle polaire arctique, ou par certaines saisons la nuit n’existe plus.
Le jour s’étend à l’infini des journées sans signe de faiblesse; à minuit, on peut encore lire en s’asseyant sous les étoiles invisibles et le soleil entêté.
Nombre de cultures à travers les âges ont craint la nuit parce que synonyme d’obscurité, elle même incarnation de nos peurs ancestrales.
Dans cette région solitaire, au nord de ce pays lointain, perdu aux confins du monde, où par certaines saisons la nuit n’existe plus et le jour jamais ne faiblit, cette peur s’est dissipée.
Mais si l’un et l’autre se confondent; alors où se trouve la démarcation entre lumière et obscurité ?
A-t-elle disparu, balayée par le soleil et ses immortels rayons ?
Ou plutôt: les ténèbres qui s’écoulent seraient parvenus à nous aveugler en se drapant de son éclat.
Et Il n’existe plus.
Quoi donc ?
Le temps.
Avant-propos
Je m’appelle Nicolas Duchêne, mais certains d’entre vous me connaissent peut-être mieux comme Syd Vesper, pseudonyme sous lequel j’ai publié un roman, ainsi que plusieurs nouvelles depuis le début des années 2010.
Certains de mes lecteurs font aussi partis de mes amis sur Facebook et, à ce sujet, j’aimerais revenir sur l’un de mes posts publié durant le printemps 2015; à cette époque bon d’entre vous avaient « liké » un album photo uploadé sur ma page après un périple en Suède que nous venions d’effectuer avec ma fiancée Hélène.
Il n’était en effet guère difficile de se laisser séduire par ces magnifiques panoramas de montagnes enneigées, de troupeaux de rennes en train de paître docilement sous les sapins. Loin de moi l’idée de porter un jugement sur l’entrain avec lequel tout un chacun se lança dans une course folle et entêtée aux likes, commentaires, et autres distinctions virtuelles équivalentes de ce que l’on aurait pu appeler autrefois la « popularité de cour » (peut-être était-ce d’ailleurs le cas; ma connaissance de l’Histoire est lacunaire).
Là n’est pas le point auquel je souhaite en venir.
Mon propos est qu’il existe une autre réalité.
Elle se dissimule – justement sous les likes, commentaires, émoticônes et j’en passe-. Ne pouvant plus l’ignorer j’ai longuement réfléchi à la meilleure façon d’amener la chose, aussi, je m’excuse d’avance de vous avoir appâté lecteurs, en donnant à la chose la forme d’une nouvelle et tout ce que cela implique: une belle histoire, diverses péripéties et un dénouement plus ou moins heureux, car ce que je vais vous raconter maintenant n’est pas une histoire mais la réalité (plaise à chacun de la trouver belle ou non.)
Il s’agit de ce qui s’est factuellement passé lors de notre séjour en Suède avec ma chère et tendre Hélène, durant le mois de mai 2015 et comment cette même réalité – à présent je ne suis même plus très sûr – s’est dérobée sous nos pas comme une fine couche de glace tapissant les eaux.
Encore une fois et par avance je m’excuse auprès du lecteur pour ce qui va suivre.
Il s’agit ni plus ni moins que du meilleur moyen que j’ai pu trouver de passer définitivement cette épreuve.
PREMIÈRE PARTIE
(CARNET DE ROUTE)
Suède #Stockholm #Aéroport #Umeå #TrueSwedishBlackMetal
Reprenons donc depuis le début, mais dans les grandes lignes.
Je vous épargnerai les détails techniques de notre arrivée en Suède qui – bien qu’elle fut passionnante en ce qui nous concerne – ne revêt au final qu’une importance très relative par rapport à ce qui va suivre.
Le lecteur impatient pourra sans doute passer outre les pages qui vont suivre pour se rendre sans plus tarder à la première partie de l’histoire, mais qu’il me soit permis de l’avertir qu’il risque en procédant ainsi de ne pas avoir toutes les clés de l’intrigue en main et ne pas la saisir pleinement, dans toute sa latitude.
Pour résumer notre voyage de la manière la plus courte et à la fois exhaustive, disons que nous atterrîmes à Stockholm en pleine nuit, nous contraignant de ce fait à dormir dans l’aéroport jusqu’à l’heure du premier train. Notre destination initiale était la ville d’Umeå, nichée sur la côte est, pas très loin de la mer, à mi-distance dirai-je entre le nord et le sud du pays. Une ville à l’aspect industriel – pour tout dire sans grand intérêt – mais où se trouvait l’agence de location de la voiture, avec laquelle nous avions prévu de remonter loin au nord, jusqu’à la ville minière de Kiruna.
Pour les quelques personnes que cela pourrait intéresser, je me contenterai de faire remarquer qu’Umeå possède l’une des plus fortes concentrations de groupes métal et punk au monde; la ville, forte d’une centaine de milliers d’habitants compte en effet parmi ces rangs des formations célèbres telles que Refused, Meshuggah ou encore Cult of Luna, parmi d’autres.
(Information tout à fait désopilante pour une ville perdue au fin fond d’un pays comme la Suède, si vous me demandez mon avis.)
Pour revenir au voyage; après un certain temps d’accommodation avec la voiture à transmission automatique – un break de la marque nationale Škoda qui nous coûta quelques frayeurs sur un rond-points ou deux – nous étions prêts à se lancer vers le « Grand Nord », comme j’aimais l’appeler.
#Skellefteå #HeavyRain #PetiteMaisonDansLaPrairie
Le voyage jusqu’à Skellefteå, ville à proximité de laquelle nous avions convenu de passer la nuit, se fit sans encombre, bien que sous une pluie battante. Nous avions loué là-bas une maisonnette, propriété d’une petite famille occupant une ferme voisine d’après ce que y était ressorti de mes quelques échanges de mails avec nos hôtes.
Nous arrivâmes aux environs de 20h. La nuit se laissait encore désirer mais trop absorbés que nous étions par l’environnement, ce détail ne nous perturba pas outre mesure. La maison surplombait un immense lac aux eaux miroitantes et entouré de petites collines recouverte d’une épaisse forêt de différentes espèce de conifères. Nous garâmes la voiture dans l’allée de terres qui bordait la propriété et à peine avions-nous commencé à déballer nos affaires qu’une silhouette toute emmitouflée d’un gros blouson jaune fluo apparut à l’autre bout de la route, près de la ferme voisine. Il s’agissait de Styna, notre hôte. Celle-ci avait du voir ou entendre la voiture arrivée, (la circulation étant quasi nulle dans les parages) et venait à notre rencontre. C’était une charmante dame d’une quarantaine d’années, taille moyenne, des cheveux très blonds, de petits yeux bleus, et un visage plutôt carré – taillé dira-t-on pour faire face à la rudesse du climat, (un pur cliché très certainement mais les clichés existent n’est-ce pas pour une bonne raison ?)
Elle nous présenta la maison, ainsi que les différents points d’intérêt du coin; entre autre il était possible de faire une jolie promenade en remontant la colline qui se dressait au fond du jardin jusqu’à un petit lac et une source d’eau potable. Elle prit congé après nous avoir indiqué la réserve de bois, ainsi que les arbres qu’il était éventuellement possible de couper en cas de besoin. Un coup d’oeil au stock actuel me permit cependant de voir que cela ne serait sans doute pas nécessaire comme il devait y en avoir déjà suffisamment pour chauffer un bataillon pendant un mois.
(S’il est bien une chose que j’ai apprise sur la Suède, c’est qu’il y a beaucoup de bois et que ses habitants sont très enclins à en tirer partie).
Sur ce, notre hôte, dont le métier était menuisière ou bucheronne – je ne sus jamais exactement – nous quitta peu après, non sans une invitation à venir lui passer le bonjour le lendemain matin à elle et sa famille.
Nous sentions à présent le froid s’immiscer peu à peu dans la maison et nous empressâmes d’allumer un feu. Sa douce chaleur se répandit vite d’une pièce à l’autre et nous préparâmes le dîner.
Nous passâmes ensuite une heure ou deux à lire et discuter dans le salon, au gré de nos humeurs et de l’intérêt que nous portions à nos ouvrages respectifs. Au dehors le jour s’était entre temps éteint et pourtant l’obscurité avait quelque chose d’étrange, une sorte de faiblesse et cette insuffisance était d’autant plus troublante qu’on approchait des minuit. Je voulus faire part de cette réflexion à Hélène mais lorsque je me retournai, celle-ci s’était déjà lovée dans le sofa et dormait d’un sommeil paisible. Je feuilletai encore quelque pages de mon livre et la réveillai doucement pour la conduire jusqu’à la chambre où un grand lit en chêne massif nous attendait.
#Randonnée #Barbecue #Storforsen #DernièreMaisonSurLaGauche
Le lendemain, après une marche de deux ou trois heures à travers les collines qui nous conduisit à un petit lac perdu en forêt et une source naturelle d’eau potable, nous fîmes un barbecue dans un abris en bois indiqué par Styna.
Celui-ci avait été collectivement bâti par des habitants du coin et il ne fait nul doute, à la vue du magnifique ouvrage ainsi que des matériaux utilisés, que ce n’était ni les bons bucherons, ni les bons menuisiers, ni le bois de qualité qui faisaient défaut dans les parages. Lorsque nous arrivâmes, Styna, accompagnée de sa famille ainsi que d’un groupe d’amis quittaient les lieux après avoir pris soin d’entretenir le feu en prévision de notre venue. (Cela bien sûr, ne fit que nous conforter dans l’opinion déjà flatteuse que nous avions de notre hôte). Nous fîmes cuire des saucisses ainsi que tout un tas d’autres aliments qui nous passèrent sous la main et il devait être quinze heures lorsque nous redescendîmes à la maison, préparer nos affaires pour le départ.
Avant de partir, nous fîmes une ultime halte chez Styna qui en profita pour nous faire visiter sa bergerie ainsi que son atelier de menuisier, rempli d’outils dont l’utilité m’échappait complètement pour la plupart. Les adieux effectués et après une manoeuvre laborieuse avec l’immense Škoda break, nous reprîmes notre route pour le nord. Notre prochaine destination était les chutes de Storforsen, l’un des joyaux suédois de la nature semblait-il. Il nous fallut moins d’une demi journée pour atteindre le village de notre seconde étape, là où nous avions loué faute de choix une autre grande maison parfaitement disproportionnée pour notre usage.
L’endroit était assez triste en comparaison de ce que nous avions vu un peu plus tôt à Skellefteå. Le village en question (j’ai oublié son nom) m’aurait même paru abandonné s’il n’y avait eu des voitures dans chaque allée de maisons. Nous fîmes le tour de la ville comme il n’était que 18h alors que le rendez-vous avec notre hôte pour récupérer les clés n’avait été pris qu’à 19h. Je ne voyais qu’une succession de maisonnettes à l’aspect piteux, s’alignant les unes aux côtés des autres, séparées de vagues clotûres à moitié défoncées, mais aucune trace d’habitants. Un peu plus bas, il y avait une pizzeria ainsi qu’un minuscule supermarché, tous deux juste à côté du fleuve et je songeai que la frontière entre piteux et pittoresque ne tenait décidément qu’à peu de choses. En autres circonstances, avec un arrangement quelque peu différent, les lieux auraient pu me sembler charmants, mais tout cela ne m’évoquait qu’isolement extrême et idées sombres. Cela me fit penser à un voyage que j’avais effectué un peu plus tôt dans le vieux sud des États-Unis où l’on trouve une population injustement dénigrée que l’on appelle « White Trash » et vivant dans des conditions similaires, pleines d’une sorte de doucereux abandon. Le fleuve était enjambé par un immense pont que nous prîmes la peine de traverser mais la route qui suivait ne faisait rien d’autre que se perdre de plus en plus dans les bois donc nous fîmes demi-tour. Il allait être de toute façon bientôt 19h. Nous engouffrâmes la voiture dans une contre-allée débouchant sur une rue étroite et nous mîmes à chercher le numéro. Nous le trouvâmes sans difficulté. Un gros 4*4 occupait déjà presque tout l’espace de la montée de garage, aussi je garais la Škoda un peu en retrait afin que notre hôte (nous supposions que c’était le sien) puisse manoeuvrer facilement. C’était un homme d’une quarantaine d’année, la mine avenante. À peine avions-nous mis un pied hors de la voiture qu’il vint à notre rencontre. Il nous fit faire rapidement le tour de la maison, donna quelques recommandations de passage, puis s’en alla. Il y avait à notre grande joie une chaîne hi-fi couplée à une paire d’enceintes et nous profitâmes de l’occasion pour dîner en musique, las de n’avoir pas encore trouvé le moyen de régler l’autoradio suédois de la voiture pour y connecter un iphone. Hélène prépara le repas pendant que j’étudiais notre itinéraire du lendemain pour se rendre aux chutes de Storforsen. La musique (Paul Kalkbrenner) retentissait dans toute la maison, s’efforçant d’insuffler un soupçon de vie à l’endroit. Depuis notre arrivée nous n’avions guère qu’entraperçus quelques habitants de ci de là; des silhouettes hésitantes errants entre les allées. Nous n’avions pas encore atteint le nord du pays, là où les températures sont les plus basses, que déjà le froid engourdissait paysage et êtres vivants. Le jour tomba bientôt mais pour ne laisser place, plus encore que la veille, qu’à une demi-nuit atone qui atteint son paroxysme aux environs de vingt-trois heures.
Notre hôte nous ayant prié de choisir la chambre qui nous conviendrait le mieux, nous optâmes pour celle se trouvant à l’étage, dont le matelas nous paraissait le plus confortable…
Ce notre choix dut se révéler être le bon comme moins d’un quart d’heure plus tard, le sommeil s’était abattu sur nous.
#Storforsen #Cascade
La journée du lendemain s’ouvrit sur un ciel clairsemé de nuages menaçants mais aussi de fragments de ciel bleu. L’air était froid et vif mais l’on pouvait sortir sans bonnet ni écharpe. (En somme c’était un beau jour de mai dans cette région du pays). Après un copieux petit déjeuner nous pliâmes bagages et reprîmes la route en direction des chutes de Storforsen.
Nous roulions depuis une dizaine de minutes lorsque la route se mit à remonter, serpentant parmi les collines jusqu’à un parking.
Les chutes s’offrirent bientôt à nous, dans toute leur majesté.
Il fallait d’abord franchir à pieds un grand champ de pierres perdu au milieu des arbres et espacé de gisements d’eau, traverser quelques ponts en bois et enfin l’on atteignait la lisière de cette étendue d’écume tourbillonnante et déchaînée. La force du courant nous laissa sans voix. Des milliers de mètres cubes se déversaient sous nos yeux à chaque seconde. L’eau semblait bouillir avant de se déverser plusieurs centaines de mètres en contrebas.
Du reste, la nature sauvage cernait les environs et il était difficile de comprendre comment un tel déchaînement en était venu à se lover dans cet écrin de verdure transi par le froid, où l’herbe même avait toutes les peines à survivre et seuls les sapins semblaient à leur place. Nous explorâmes les différentes ramifications des chutes, lesquelles s’étiraient sur plusieurs centaines de mètres avec non pas un brutal à pic comme cela pouvait être le cas de celles du Niagara par exemple, mais plutôt toute une série de rebonds.
#Jokkmokk #Sarek #Camping #NuitLaPlusFroide
Après une bonne heure, nous reprîmes la route, toujours en direction du nord, vers le parc naturel du Sarek où nous avions prévu de camper pour la nuit. Il allait nous falloir plusieurs heures et puisqu’il était encore tôt nous avions prévu de faire escale à Jokkmokk, un village inuit situé à mi-parcours. Nous l’atteignîmes aux environs de quatorze heures et en profitâmes pour nous approvisionner en nourriture et essence. Une superbe église au bois peint tout de blanc trônait au milieu de la ville.
Le reste n’avait que peu d’intérêt donc nous ne restâmes pas plus d’une heure avant de reprendre la route.
La neige se faisait de plus en plus présente sur ses abords et les intersections de plus en plus rares à mesure que nous progressions vers le nord. Les rennes se faisaient de plus en plus fréquents et de moins en moins farouches, à tel point qu’il était parfois nécessaire de freiner et de les contourner, comme certains se laissaient à peine perturber par notre voiture.
Au bout de quelques heures, nous atteignîmes l’Akkajaure, un lac barrage voisin du Sarek, lui même enclavé derrière de hautes montagnes que nous apercevions au loin, sur l’autre berge. Nous fûmes surpris de constater qu’il était encore gelé à cette période et tirâmes de ce fait un trait sur notre idée de le traverser en bateau pour aller faire un tour dans le Sarek, « l’un des parcs naturels les plus difficiles d’accès au monde » d’après ce que j’avais eu l’occasion de lire et dont je comprenais à présent la raison. Une route alternant terre, neige, gravier, et parfois un reste d’asphalte longeait les rives du lac en plongeant vers l’ouest, vers la frontière norvégienne. Nous la suivîmes pendant une grosse demi-heure avant d’arriver à un cul de sac désert, en fait un simple embarcadère, vraisemblablement celui du bateau servant à faire la traversée aux « beaux jours ».
Nous fîmes donc demi-tour, en quête d’un endroit où planter notre tante et l’affaire fut réglée au bout d’un quart d’heure lorsque nous aperçûmes en contrebas, un petit coin situé juste au bord du lac, là où les rochers alentours offraient une protection convenable contre le vent, et où la neige semblait suffisamment dense pour y planter une tente. Nous déchargeâmes tout notre barda du coffre et sac sur le dos, commençâmes notre descente entre les sapins, nous enfonçant dans la neige parfois jusqu’à la ceinture.
Dix bonnes minutes furent ainsi nécessaires pour atteindre l’objectif et nous fûmes soulagés de voir que la neige formait ici comme nous l’avions supposé une épaisse croute de glace bien assez solide pour supporter les sardines d’une tente de montagne. Après nous être débarrassés de nos lourds sac à dos nous entreprîmes de la monter, exercice qui se fit avec bien moins de difficulté que lors de notre première tentative d’essai, une semaine plus tôt dans le jardin de mes parents.
L’opération fut rondement menée en un rien de temps. (Une très bonne chose comme le soleil déclinait à présent à la même vitesse que la température).
Hélène sortit les aliments pour préparer le dîner tandis que je parcourus les alentours à la recherche de bois pour notre feu de camp. A ma grande surprise, j’en trouvais disséminé un peu partout autour, vestiges de végétation n’ayant pas survécu à l’hiver. Après une demi-heure d’allers-retours au camp, nous avions assez de combustible pour le reste de la soirée et un grand feu se dressa bientôt – après que je me sois époumoné plusieurs minutes durant pour entretenir la flamme qui peinait à trouver son foyer -. Nous avions donc établi notre « cuisine » de fortune sur un long éboulis de rochers voisin de notre camp. Il offrait l’avantage d’être lui aussi correctement protégé du vent. Hélène avait sorti les saucisses, le jambon et les chips et il est je pense inutile de s’appesantir sur le fait que les uns comme les autres ne firent pas long feu après la journée d’efforts que nous venions de passer.
Alentour, le jour continuait de décliner, mais nous ne nous attendions plus à voir tomber la nuit. Vers 21h30, nous savions qu’elle avait atteint son intensité maximale et l’on pouvait encore lire les inscriptions sur les emballages. Le froid en revanche se faisait de plus en plus mordant, bien que nous nous rapprochions de plus en plus du feu, emmitouflés dans nos épais anoraks, écharpes, gants, bonnets et bottes épaisses. J’avais lu dans un livre que la zone dans laquelle nous nous trouvions faisait partie du cercle polaire arctique.
La tente dont j’avais fait l’acquisition un peu avant notre départ était un modèle de montagne réputée de très bonne facture mais j’appréhendais tout de même le moment où nous devrions y pénétrer, nous débarrassant de nos sur-couches pour s’engouffrer dans nos sacs de couchage. (Cette dernière étape en particulier.)
Nous finissions nos dernières denrées.
Au loin, de l’autre côté du lac, les montagnes enneigées délimitant le parc national du Sarek nous jonchaient. Les halos roses bleutés couronnant leur sommet au chien loup s’étaient maintenant estompés au profil d’un bleu sombre plus menaçant et l’ensemble nous était à présent inhospitalier. Les rochers s’étaient couverts d’un sombre glacis et la neige davantage rigidifiées si bien que le ronronnement étouffé et apaisant de nos bottes sur elle s’était mu en une sorte de craquement sinistre. Nous buvions une Guiness en partageant nos pensées sur les lieux. Hélène avait de plus en plus froid et il ne fallait pas s’éloigner du feu à plus de trois mètres sous peine de se mettre à grelotter. Alentour de ce cercle de chaleur et de lumière réconfortante, le froid était âpre et corrosif. Le ciel s’était ouvert et les nuages avaient fui à l’ouest, là où la faible lueur du jour irradiait encore un peu. Il était presque 23 heures. Je terminai la Guiness. L’alcool m’apportait une sensation de chaleur. Tout autour de nous, les pierres muettes et bleuies par le froid et la nuit nous contemplaient. Nous observâmes le lac, immense et immaculé se fondre dans une obscurité relative et encore plus loin, sur l’autre rive, les montagnes inhospitalières l’imitèrent rapidement. Elle pouvait être à cinq ou cinquante kilomètres. Comme la perspective, vide et dénuée de repère trompait l’oeil, je n’aurais su dire.
Aux alentours de 23h30 le feu ne nous préservait plus de la morsure du froid donc nous décidâmes dans un élan de courage d’aller nous lotir sous la tente. Les dix mètres qui nous séparaient du campement furent un supplice, et plus encore l’action de nous contorsionner pour passer l’abside et rentrer dans nos duvets après avoir ôté nos vêtements les plus encombrants. Nous grelottions de tous nos membres. La toile orange de la tente de montagne ajoutait à notre trouble comme elle ne faisait qu’éclaircir davantage la « nuit » polaire.
Nous dormîmes très peu cette nuit là.
Chaque fois que nous parvenions à trouver le sommeil, le froid se rappelait à nous, s’accrochant à la toile de tente comme une sangsue, puis, perçant à jour nos duvets, nos couches de vêtements jusqu’à atteindre nos chairs. En dessous la neige s’était tassée et avait à présent la dureté d’une dalle en béton. Nous luttâmes toute la nuit et les brèves accalmies de la bataille, nous les comblâmes autant que possible par de micro-sommeils de quelques dizaines de minutes.
Aux alentours de 7h du matin nous étions à bout de force et décidâmes de sortir de la tante. Le soleil se levait tout juste et nous espérions y trouver un certain réconfort. J’ouvris la toile de l’abside et passai une main dehors. Je la rentrai aussitôt, mordu par le froid jusqu’à l’os. Hélène se tenait en tailleur, couverte de tout ce qu’il lui était passé sous la main durant la nuit. J’enfilai mes épaisses chaussures en hâte ainsi que le reste de mes vêtements et sortis de la tente d’un pas chancelant, estomaqué par l’air glacial. Elle me suivit quelques instants plus tard, essayant de se réchauffer les membres en les frottant avec énergie. Nous repliâmes la tente sans dire un mot. Après quelques minutes je ne sentais plus mes doigts de pieds. Je sautai sur place pour faire circuler le sang. Hélène rangeait pendant ce temps le reste de notre matériel. Elle me dit qu’elle ne se sentait pas bien et je la vis s’éloigner en direction de la voiture. Je me hâtai de réunir mes affaires, jetai mon énorme sac sur mes épaules et me lançai derrière elle. La neige avait bien durci durant la nuit, elle s’était enduite d’un solide épiderme de glace donc la marche fut moins difficile qu’à l’aller. En moins d’une dizaine de minutes nous étions tous deux à la voiture, expédiant nos sacs dans le coffre. Je laissai tourner le moteur au ralenti une autre dizaine de minutes avant de démarrer. Hélène avait mauvaise minutes. Elle ne parlait pas et se frottait les membres sans discontinué. Je n’étais pas fier non plus. De toute ma vie je n’avais ressenti un tel froid. Ça n’était pas les vacances au ski dans les alpes, c’était bien le cercle polaire arctique et ce n’est que plus tard, en regardant sur une carte que je me rendrai compte à quel point nous étions loin dans le nord, aux avant-postes des limites du monde, des frontières au delà desquels rien ne pousse ni ne vit. Il nous fallut une grosse demi-heure avant de retrouver une route digne de ce nom, c’est à dire faite d’une majorité d’asphalte. Nous nous étions entre temps ragaillardis grâce au chauffage de la voiture mais la fatigue nous plombait toujours.
#Gällivare #Fatigue #Déprime
Lorsque nous atteignîmes Gällivare, aux environs de 9 heures, la ville était encore à moitié endormie. Nous trouvâmes un petit coin où garer l’auto à proximité de la gare et cela fait, le sommeil s’abattit sur nous.
Il était environ 11 heures lorsque nous fûmes réveillés par les rayons du soleil à travers le pare-brise. Comme de coutume en Suède il y avait des tables de pique-niques équipées de grilles à barbecue pas très loin, sur une espèce de promenades où les habitants semblaient venir faire leur jogging. Gällivare étant une station de ski réputée, je présumais que pas mal de ses habitants devaient être des skieurs de haut niveau habitués à un entraînement régulier. Il y avait en tout cas un nombre impressionnant de coureurs de tout âges proportionnellement au nombre d’habitants qui ne devait pas dépasser les 10 000. Nous nous installâmes sur l’une des tables et prîmes un copieux petit déjeuner, le corps toujours sous le choc de la nuit passée.
Nous fîmes ensuite un tour ville, laquelle avait tout l’aspect d’une station de ski hors période de vacances : vide et délaissée. Quelques vieux traînaient en groupe dans le centre, près de l’église, mais tout le reste des habitants semblaient réellement être en train de faire leur jogging. Nous fîmes une boucle pour revenir à la voiture et passâmes un petit moment à étudier notre carte afin de déterminer ce que nous allions faire du reste de la journée. Kiruna était à moins d’une demi-journée de route et nous étions en avance sur notre itinéraire. Je suggérai que nous fassions un détour par un petit village que j’avais repéré sur la carte et qui accueillait semble-t-il une église valant le détour. Hélène fut enthousiaste à cette idée et cela remit un peu de bonne humeur dans la matinée.
Nous quittâmes Gällivare aux environs de 12h et regagnâmes la route principale. Véritable épine dorsale du pays, fuyant vers le nord, avec pour seules intersections de minuscules chemins, le plus souvent de terre, bifurquant de temps à autres sur la droite et la gauche pour s’échouer en quelque endroit toujours plus reculé et difficiles d’accès.
Nous poursuivîmes donc notre chemin, montant et descendant parmi les collines mais filant tête baissée à travers un paysage réduit au bleu du ciel et au vert sombre d’une végétation baignant dans la blancheur immaculée de la neige.
Il nous fallut repasser à deux reprises devant notre bifurcation pour nous assurer qu’il s’agissait de la bonne. Aucun nom, aucun panneau n’y figurait, mais d’après notre carte, c’était la seule à se trouver immédiatement après un petit lac. Or nous venions justement d’en passer un donc j’estimai que la marge d’erreur était assez faible et nous courûmes le risque.
Après une centaine de mètres l’asphalte commença à s’effriter et deux minutes plus tard la route n’était plus qu’un chemin de terre parsemé de cailloux et pleine de nids de poules d’une profondeur suffisante pour faire éclater les pneus de n’importe quelle automobile. Nous décidâmes de rouler au pas, avec la plus grande prudence. Appeler une dépanneuse n’était ici pas une option. Il n’y avait aucun poteau électrique, aucune ligne de téléphone. Le chemin s’enfonçait vers l’ouest en direction d’un village dont je ne savais rien hormis qu’il comprenait une église à priori digne d’intérêt. Nous fîmes halte dans une petite clairière ensoleillée et la petite pause pour se « dégourdir les jambes » se transforma en une sieste improvisée d’une heure, à même la mousse, étonnement sèche et moelleuse qui jonchait le sol à cet endroit.
Nous reprîmes la route et au bout d’une dizaine de kilomètres, le paysage vira d’une épaisse forêt de sapin à une plaine enneigée dont émergeaient les cimes de petits arbustes. Quelques arbres poussaient ça et là mais de l’ensemble émanait un vague sentiment de désolation, comme un paysage de fin du monde. Il nous fallut encore près d’une demi-heure pour atteindre ledit village.
Notre déception fut à la hauteur de la crainte que nous avions vu peu à peu grandir au fil de la route. La voiture atteignit une place circulaire faite de terre humide et de cailloux, comprenez: un cul de sac. Nous nous y garâmes. Il y avait bien une petite église à côté mais elle était entièrement ensevelie sous la neige et l’on ne pouvait guère que la deviner, ainsi que son parvis. Elle était faite de bois – comme à peu près toutes les constructions dans cette partie de la Suède – mais peint en rouge, ce qui lui donnait tout de même un certain cachet. Nous nous installâmes sur un petit banc et déjeunâmes, l’air piteux, démoralisés par la fatigue.
Au loin, le son d’une scierie se faisait entendre par intervalles. Quelqu’un devait être en train de découper du bois et pourtant il semblait n’y avoir aucune vie alentour. « Le village » était un drôle de nom pour cet endroit qui se résumait objectivement à une place en terre sans aucun indicatif, une église et quelques mobile home disséminés tout autour. Aucun habitant n’était en vue.
Après le repas je fis quelques enjambées jusqu’à un panneau de bois grossièrement planté dans le sol et auquel était greffé sous verre une grande feuille abîmée par la morsure du soleil et du gel. Il s’agissait d’un plan du village tracé à la main. Chaque maison y était indiquée de façon approximative, accompagnée d’une lettre dont on trouvait la référence dans une légende située en bas de la feuille et indiquant les noms des habitants. J’en dénombrai une trentaine, ce qui était raccord avec le groupement de boîtes à lettres situé juste à côté du panneau: trois rangées d’une dizaine chacune. Leur peinture était écaillée et leurs socles tordus.
Nous remontâmes en voiture, toujours aussi fatigués en plus de l’agacement d’avoir perdu plusieurs heures dans ce « détour » comme nous n’hésitions plus à le baptiser.
Nous refîmes exactement le même trajet qu’à l’aller, ce qui acheva de plomber l’ambiance déjà morose.
#Kiruna #Réconfort #Ballet #Coppelia
Les heures suivantes s’écoulèrent, silencieuses, et en fin d’après-midi nous atteignîmes les abords de Kiruna, la plus grande ville du nord de la Suède.
Vu notre état de fatigue et comme il était urgent de trouver un endroit où planter notre tente, nous reportâmes sa visite au lendemain. Nous fîmes le tour des environs sans trouver d’endroit satisfaisant. Au sud de la ville, il y avait une sorte de campements de maisonnettes faites de tout et de rien. Des enfants arpentaient la route à dos de poney. Nous ne parvînmes à savoir s’il s’agissait d’un campement légal ou non, comme beaucoup de choses dans cette partie du pays semblaient échapper au contrôle des autorités, faute d’y être représentées.
Après les dernières heures que nous venions de passer, je vis bien qu’Hélène ne passerait pas une nuit supplémentaire dehors et – pour être honnête – ce n’était pas loin d’être aussi mon cas, donc, lorsque nous passâmes devant une sorte de camping proposant entre autre des hébergements en dur dans des chalets, mon sang ne fit qu’un tour et j’y engageai la voiture sans un mot. L’endroit était vide à cette période de l’année et je craignis même que le portail d’entrée n’eut été laissé ouvert que par la négligence des propriétaires. J’allai néanmoins jusqu’à l’espèce de pavillon d’accueil et lus sur la porte qu’il était fermé depuis une dizaine de minutes. Je frappai énergiquement. Personne ne vint. Un numéro était inscrit sur le papier. Je le composai. Une voix féminine avec un fort accent espagnol répondit à la cinquième sonnerie. J’expliquai la situation en anglais et quelques instants plus tard, une dame à la mine sympathique nous rejoignit dehors. Celle-ci vivait ici avec sa famille et louait des gîtes toute l’année, encore que cette saison n’était bien sûr « pas la plus florissante ». A notre grande surprise, et aussi notre grande satisfaction, celle-ci parlait un français plus que correct et il nous fallut moins de cinq minutes pour récupérer les clés de notre gîte, situé aux abords d’un immense lac gelé. Elle nous indiqua le sauna un peu plus loin, ainsi que tout ce qu’il était possible de faire sur le camp. Au loin on entendait des aboiements et elle nous expliqua qu’il s’agissait de la meute de chiens de traîneaux, ici rentrée en cage, qui devenait nerveuse à cette période, lorsque l’activité diminuait. Notre gîte était un petit chalet monté sur pilotis et comportant une terrasse. L’intérieur n’avait rien de luxueux ni de causy mais collait bien à l’atmosphère de l’endroit, où la vie semblait aussi rude que l’hiver et le froid. C’était sans compter qu’avec les dernières 24 heures que nous venions de passer, n’importe quel endroit nous aurait contenté pourvu qu’il soit chauffé et dispose d’une douche avec eau chaude et cuisine. Il n’y avait que des lits superposés à l’intérieur. Les matelas et oreillers ne semblaient pas avoir été lavés depuis un moment mais c’était effectivement écrit sur la feuille des lieux – bien qu’en d’autres termes – comme me le fit remarquer Hélène: « les locataires doivent apporter leur propre literie ». Il était environ 19 heures. J’allumai la télévision et pianotai d’une chaîne à l’autre en quête d’un peu d’animation. Je tombai sur un documentaire en suédois portant sur une compagnie de ballet. Hélène prit sa douche pendant que je commençai à préparer le repas.
Nous échangeâmes les rôles après qu’elle eut fini et mangeâmes devant « Coppelia », ce qui fut pour l’un et l’autre je pense la meilleure façon de mettre un terme à cette dure journée.
La journée du lendemain démarra sur un ciel grisâtre. Hélène voulut aller voir la meute de chiens avant de partir. À notre approche, certains des huskies se mirent à aboyer et montrer les crocs. J’imaginai qu’il devait s’agir des chef de meute, les « premiers de cordée » sur l’attelage. Les autres nous observaient d’un oeil tranquille, encore qu’alerte. Ils devaient être une quinzaine répartie en deux cages où avaient été posés des abris en bois aggloméré. Le sol était fait de cailloux et en un mot comme en cent l’ensemble n’avait rien du charmant petit abris pour animaux domestiques. Ici, les chiens plus encore que les hommes n’échappaient pas à la rudesse de la vie.
Nous quittâmes le camping en direction de Kiruna. La plus grande ville du nord de la Suède comme je crois l’avoir déjà dit. Là se trouvait également la plus grande mine de fer au monde. Il ne nous fallut qu’une quinzaine de minutes pour atteindre le centre-ville. Kiruna était donc une cité minière d’une vingtaine de milliers d’habitants, acculée au nord par une chaîne de hautes montagnes. Mais c’était précisément ces montagnes qui faisaient vivre la ville depuis plus d’un siècle. Quelques rapides recherches m’avaient appris que l’immense majorité des habitants travaillaient pour la compagnie minière exploitant l’inépuisable filon gisant dans son sous-sol. Depuis une dizaine d’années la commune avait d’ailleurs entrepris un vaste processus de délocalisation de la ville comme les forages à des profondeurs extrêmes menaçaient de la faire effondrer sur elle même. Ce chantier était prévu pour s’étaler sur environ un siècle.
Nous garâmes la voiture pas très loin d’une église à l’aspect pour le moins étonnant puisqu’en bois rouges (cela, nous commencions à en avoir l’habitude) mais surtout de forme pyramidale. Celle-ci contrastait par son apparente fantaisie avec le reste de la ville qui, de par sa vocation de cité ouvrière, respirait la morosité. Elle m’inspirait le cliché de ces vieilles cités soviétiques où le béton nue habille seul les façades des bâtiments et où chacun perd de son humanité, emmitouflé sous une épaisse couche de vêtements. Même le trafic semblait transi par le froid. Notre gîte du soir était une petite cabane sans eau ni électricité qui se trouvait à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de la ville, et comme je n’avais aucune adresse précise pas plus que d’estimation exacte du temps que nous aurions pu perdre à la chercher, nous décidâmes de nous arrêter dans le grand centre commercial aperçu au sud de la ville pour refaire le plein d’essence et déjeuner. Il y avait une sorte de Mac Donald suédois à l’intérieur: une chaîne de fast-food dont nous avions déjà croisé plusieurs enseignes au cours du voyage. Nous y commandâmes des menus burger, frite et cola pendant que notre lessive tournait dans un lavomatic voisin.
Le dîner achevé et nos affaires pliés dans les sacs, nous retournâmes à la voiture pour entamer ce qui devait être la dernière partie de notre voyage, et ce qui est en fait l’objet de mon récit.
Je demande donc au lecteur de garder tout ce qu’il a lu jusqu’à présent dans un coin de son esprit, sans qu’il ne prenne le dessus sur aucun autre évènement qui va suivre car l’objet de cette longue introduction n’était en fait ni plus ni moins que de replacer les choses dans leur contexte et aussi – je suppose pour moi -, d’y voir un peu plus clair; m’aider à prendre le recul nécessaire sur les faits qui vont suivre.
À ce stade de mon récit, ne semaine s’était écoulée depuis notre arrivée en Suède et nous nous croyions déjà forts d’une certaine expérience de son mode de vie, en particulier dans le grand nord.
Je ne sais trop comment débuter donc le lecteur m’excusera pour mon manque d’imagination mais j’opterai par le plus simple: le commencement.
Au cours du mois d’avril, alors que je cherchais des gîtes à louer pour notre escapade je tombai sur une annonce parue il y a moins d’une semaine et faisant état d’un charmant petit cottage située à une cinquantaine de kilomètres de Kiruna, la dernière des villes de notre itinéraire. Nous avions prévu de passer plusieurs jours à l’extrémité nord du pays et la description attira mon attention comme il y était question d’une totale immersion en pays lapon: la « cabane » comme on aurait pu l’appeler ne possédait ni l’eau courante, ni l’électricité, or c’était précisément le genre d’expérience dont j’étais à la recherche. Je décidai d’en faire une surprise à Hélène, tâtonnant tout de même, afin de prendre sa température; je lui en parlai avec des termes vagues bien qu’honnêtes: ne cachant rien de son manque de confort pratique etc…
Celle-ci manifesta à ma grande surprise un enthousiasme sincère. Je ne me le fis pas répéter et réservai sur le champ le « cottage » pour une semaine.
C’est donc ainsi que quelques mois plus tard (ou bien maintenant si l’on se contente de raccorde les wagons de mon récit):
Nous quittions à présent Kiruna par l’ouest, filant sur une route rectiligne qui pointait à l’horizon. Le propriétaire ne m’avait envoyé aucune adresse comme la cabane n’en comportait pas. Ici les routes n’étaient que des routes et même en ville les rues s’étaient affranchies de noms. Seule la nature sauvage nous entourait. Ma seule véritable indication avait été la capture d’écran google map envoyée par notre hôte: une pastille rouge y indiquait la position du cottage. Il avait aussi précisé qu’elle se trouvait à « une cinquantaine de kilomètres de Kiruna » et c’était bien là toutes les informations contenues dans notre échange laconique.
Je relevai donc le kilométrage après que nous ayons quitté la ville. Il indiquait 31400 km.
Hélène semblait tendue. Je lui avais demandé de prendre le volant afin de me concentrer sur le paysage. J’espérais ainsi repérer plus facilement notre cabane, d’après mon souvenir des photos de l’annonce. Je me souvenais qu’elle se trouvait à une centaine de mètres du bord d’une petite route, plantée au milieu d’une forêt d’arbres éparses et qu’une longue chaîne de montagne se dessinait au loin. Elle se trouvait également sur le côté droit lorsque l’on s’orientait vers l’ouest, détail que j’avais pu déterminer grâce à l’option « street view » de google maps. (En y repensant je trouvai extraordinaire que des personnes soient venus jusqu’ici pour cartographier ces lieux perdus).
Il était environ 20h et de sombres nuages s’étaient immiscés dans le ciel depuis notre départ de la cité minière. Nous étions maintenant accoutumés à l’absence de nuit et comme notre voyage nous avait menés toujours plus loin au nord, nous ne nous attendions plus à voir l’obscurité s’étendre passé 21h, je n’étais donc pas inquiet à l’idée de ne pouvoir reconnaître les lieux dans la pénombre.
Au bout d’une vingtaine de kilomètres le ciel était intégralement couvert d’un amas de nuages menaçants et l’on entendait au loin le grondement du tonnerre. Sur les bords de la route on voyait des rennes fuir vers l’intérieur des terres et disparaître après quelques foulées dans les sapins. L’inquiétude d’Hélène semblait s’accroître un peu plus à chaque crête que nous franchissions, comme elle dévoilait un paysage, une ligne d’horizon toujours plus inhospitalière. Pour ma part je tâchais de manifester un certain enthousiasme tout en me concentrant sur le paysage qui défilait.
Au trentième kilomètres la pluie se mit à tomber et je trouvai au plus vite une plaisanterie à faire sur la météo dans cette partie du pays. Le vent ne tarda à se lever aussi et bientôt de véritables bourrasques balayèrent la route. Hélène avait du mal à conserver le cap et je nous estimai finalement heureux que cette route soit déserte, nous n’avions en effet croisé aucun véhicule ni aucune habitation depuis notre départ de Kiruna.
De part et d’autre de l’auto, j’observais la cime des arbres ballottées à un rythme infernal et pour la première fois je me surpris à penser que j’aurais voulu être ailleurs; bien au chaud, à l’abris, même dans ce petit chalet à l’aspect de préfabriqué où nous avions couché la veille.
En quelques minutes je vis Hélène basculer les essuies-glaces de la position 1 à 3 et au quarantième kilomètres on ne distinguait presque plus rien à l’extérieur du véhicule. La pluie nous pilonnait sans interruption et l’on entendait chacune de ses gouttes se fracasser sur la carrosserie comme une décharge d’artillerie. Le son déchirant du tonnerre surplombait l’ensemble par salves brutales. Le kilométrage 31 440 s’afficha sur le compteur et je sus alors que nous étions très précisément à cinquante kilomètres de Kiruna. Je dis à Hélène de ralentir comme nous ne devions plus être très loin de la cabane et fixai l’horizon à la recherche d’un repère que le maître des lieux aurait pu nous laisser au bord de la route, signal lumineux ou morceau de tissu accroché à un arbre. Mais je ne distinguais rien d’autre que le paysage déroulant à allure réduite et balayé par les intempéries. Il était à peu près 21h et l’on se serait cru en milieu d’après-midi si les éléments n’avaient apposé au décors son voile sombre et les épais nuages filtrés les rayons du soleil. Même la neige se faisait malmenée comme je voyais d’épais bloc fondre et se détacher des pans d’herbe. Le froid était parvenu à s’immiscer peu à peu dans l’habitacle alors qu’Hélène avait déjà remonté le chauffage au maximum. Je me concentrai sur ma tâche, essayant de distinguer sur ma droite un détail familier, une évocation de ce que j’avais pu voir sur ces photos ensoleillées un mois plus tôt.
Un éclair illumina le ciel et ce paysage de désolation au moment où nous franchîmes une petite crête.
Mon regard se posa alors distraitement, presque par inadvertance, sur les boiseries vert foncé d’une minuscule cabane qui se dressait un peu plus haut, en marge de la route, tapie parmi les arbres. Je tapotai sur l’épaule d’Hélène, elle releva le pied de la pédale d’accélérateur et suivis mon doigt du regard.
― Je crois que c’est ici L’. »
*
« Tu es sûr ? » qu’elle me demanda en passant le point mort. La voiture s’arrêta à hauteur d’une espèce d’aller grossièrement tracée dans la terre que l’on voyait bifurquer depuis la route sur une centaine de mètres.
J’essayai de me rappeler du contenu de l’annonce, ainsi que des quelques photos que j’avais pu voir. L’ensemble n’avait certes pas l’aspect avenant que je m’étais figuré, mais cela devait pouvoir être mis sur le compte des circonstances. J’ouvris ma fenêtre et plissai les yeux pour mieux voir. L’aller se terminait sur une petite place recouverte de copeaux et où se dressait de part et d’autres des réserves de bois bien garnies.
J’acquiesçai. « Si ce n’est pas ici je ne vois pas où cela pourrait être. »
Nous venions en effet de parcourir une cinquantaine de kilomètres depuis Kiruna et c’était bien la seule habitation que nous avions croisé depuis (abstraction faite de quelques avant-postes de chasse tombant à moitié en ruine).
Je voyais bien à sa mine décontenancée que ça n’était pas le genre d’arrivée idyllique qu’Hélène avait dû se figurer, et pourtant nous étions bien là, coincés sous la pluie dans une voiture dont le chauffage semblait avoir de plus en plus de peine à fonctionner. Après un bref moment de silence elle repassa la 1ère et l’engagea dans l’aller. Je vis qu’un peu plus loin une rivière avait dû sortir de son lit comme une voie d’eau assez importante s’était crée sur le chemin et le cisaillait en deux. Hélène pressa les freins pour immobiliser le véhicule. Je lui dis que j’allais essayer de jauger sa profondeur et avant qu’elle n’ait eu le temps de dire un mot, avais remonté ma capuche sur ma tête et ouvrais la portière. Une trombe d’eau s’abattit aussitôt sur moi et je m’empressai de remonter le chemin de terre. Le cour d’eau ne devait avoir qu’une vingtaine de centimètres de profondeur. Je levai en même temps les yeux et vis la cabane. Il devait bien s’agir de celle de l’annonce. Les souvenirs me revenaient à présent et sa structure en bois peint tout de blanc en faisait partie, de même que cette terrasse montée sur pilotis et ses mangeoires à oiseaux. Nous étions bien là où nous étions censés être. Une violente bourrasque de vent me fit vaciller et la morsure du froid se resserra d’un coup. Je frissonnai en me hâtant de retourner à la voiture.
« Je pense que tu vas pouvoir passer sans problème L’ , criai-je à Hélène à travers la vitre. Prends un peu d’élan pour être sûr. »
Elle devait être parvenue je ne sais trop comment à m’entendre comme je la vis reculer. Les roues crissèrent sur les rochers et le véhicule bondit en avant dans l’aller. En atteignant le cours d’eau j’eus un instant de panique comme je vis le pare-choc avant piquer du nez et l’engin ralentir. Mais cela ne devait être qu’un effet du courant et de la profondeur relative du lit puisque un instant plus tard celui-ci était passé de l’autre côté et son pot d’échappement fumait paisiblement dans la petite cours du cottage. Nous nous hâtâmes d’extirper nos bagages du coffre sous la pluie battante et de remonter la petite côte qui nous séparait de la cabane. En haut, une sorte de petite cour improvisée se dévoila à notre regard. En face, à une vingtaine de mètres se dressait une construction en bois qui ressemblait fort à un sauna artisanal. Une large cheminée en taule émergeait de son toit. Sur la droite il y avait un abris en dessous duquel on pouvait voir plusieurs bâches tendues recouvrant ce qui semblait être des moto-neiges. Plus loin toujours sur la droite je repérai une cabane en cours construction et qui, bien que dans un état déjà très avancée, ne semblait pour l’heure avoir aucune utilité. Enfin sur notre gauche se trouvait la fameuse cabane. Le côté par lequel nous étions arrivés ne comportait aucune fenêtre. Nous fîmes le tour en vitesse jusqu’à une porte surélevée par deux ou trois marches. Je mis la main sur la poignée avec une certaine appréhension. D’abord parce que je n’avais eu depuis la réservation aucun contact direct avec le maître des lieux et ne pouvait donc être sûr ceux-ci seraient déjà ouverts et entièrement à notre disposition. Quelle preuve avais-je en effet que les clés n’avaient pas été dissimulées quelque part à notre attention ? Nous avions beau nous trouver dans un des coins les plus isolés du monde, un propriétaire était en droit d’être prudent vis à vis de son bien, j’en savais quelque chose.
Ma deuxième crainte, tout aussi légitime, était bien sûr que nous nous soyons trompés d’endroit et que nous nous apprêtions à pénétrer chez quelqu’un.
Je toquais à la porte et tendis l’oreille. Aucun son distinct ne me parvenait à l’intérieur, mais le vacarme assourdissant de l’averse et du tonnerre faussait toute conclusion. Le froid commençait à se faire de nouveau ressentir après notre petite course et Hélène me pressa de rentrer. Ce que je fis. J’appuyai sur la poignée de la porte qui s’ouvrit sans mal et impassiblement. Je fis un pas à l’intérieur suivit de près par Hélène qui la referma dans son dos. Nous étions dans un petit vestibule, un sas dirions-nous. Bon nombre de paires de chaussures y étaient entreposées, depuis les confortables chaussons jusqu’aux pataugas en passant par les après-skis. Je sentis une boule au creux de mon estomac, persuadé à présent de m’être trompé d’endroit.
Je fis néanmoins un autre pas en avant. « Il y a quelqu’un ? Demandais-je d’une voix hésitante. « Is there someone here ?
Aucune réponse. Le son des éléments à l’extérieur avait été mis en sourdine par l’épaisseur des murs en bois et pourtant il faisait tout aussi froid ici. J’avançai un peu plus jusqu’à me trouver dans la pièce principale. Une petite cuisine ouverte se trouvait immédiatement à droite en sortant du sas tandis que deux chambres s’étalaient cote à cote sur la gauche. Je dépassai la partie cuisine pour découvrir le reste de la pièce. Une immense baie vitrée s’étalait au fond, offrant une magnifique vue sur les alentours. Il y avait une banquette d’angle dans le recoin formé par la cuisine et le reste de la pièce. Une imposante table basse en pin s’y trouvait posée au centre. Un peu plus loin une étagère, en pin elle aussi, abritait une modeste collection de livres. Contre le mur opposé au canapé se trouvait un vieux poêle avec tout l’attirail de pinces en métal nécessaires à son fonctionnement. Enfin, tout de suite sur la gauche en entrant, juste à côté de la cuisine se trouvait une petite table en bois ainsi que quatre chaises.
Du reste il n’y avait pas âme qui vive et – c’était peut-être encore un peu tôt pour se prononcer – mais l’endroit avait un charme tel que l’on en voyait que rarement. Hélène s’avança à ma hauteur et fouilla à son tour la pièce du regard. Hormis les chaussures, l’endroit n’offrait aucun signe visible d’occupants, et je finis par me dire qu’elles appartenaient selon toute vraisemblance à la famille du propriétaire qui les avait laissées là par soucis de commodité.
Les plaids sur le canapé avait été plié avec soin, comme en prévision de notre arrivée. Nous échangeâmes un sourire… jusqu’à ce que le froid se rappelle brusquement à nous au moment ou une bourrasque fit trembler la forêt, nos murs et qu’une puissante salve de pluie s’abattit sur la baie vitrée. Il nous fallait allumer ce poêle au plus vite. Je fouillai les lieux du regard et aucun fagot de bois ne m’apparut. Hélène me rappela les réserves aperçues à l’extérieur, dans la petite cours où nous avions garé l’auto et j’acquiesçai en me re-dirigeant vers le sas.
Les éléments se jetèrent à mon visage au moment où j’ouvris la porte. Je la claquai derrière moi et piquai un sprint jusqu’aux abris. Une formidable quantité de buches y étaient entreposés mais à peine avais-je mis un pied qu’un mauvais pressentiment me saisit.
Sa couleur me semblait anormalement foncée pour du sapin.
Il ne me fallut pas plus d’une dizaine de secondes pour me rendre compte que les fagots avaient été trempés par la violence des intempéries. Même les mieux protégés des éléments, ceux que l’on trouvait le plus au centre du tas, étaient encore chargés d’humidité. J’en prenais quelques buches parmi celles que je jugeai être les plus sèches, autrement dit les plus à mêmes de brûler, et les enveloppai dans ma veste avant de remonter au pas de course me mettre à l’abris dans la cabane. J’y trouvai Hélène, toute frissonnante, ensevelie sous une montagne de couverture. Je posai les buches à côté de l’âtre et entrouvris sa porte en fonte. Il n’y avait aucune trace de cendres, signe que l’on n’avait pas dû y faire de feu depuis un moment, ou bien que l’appareil avait été méticuleusement entretenu il y a peu. J’y plaçai une buche et Hélène m’indiqua qu’elle avait vu une boîte d’allumettes dans la cuisine. Je revins avec la précieuse boîte, en sortis une et balayai la pièce des yeux à la recherche de combustibles instantanés. Il n’y avait nulle trace d’allume feu ou alcool à brûler. Je fouillai l’armoire. Rien d’autre que des livres. Je ne pus me faire à l’idée d’en réduire un en cendre, tant bien même qu’il s’agissait pour la plupart de best-sellers de Stephen King ou Danielle Steel, ouvrages dont je ne doutais pas qu’il puisse être remplacé facilement. Je poursuivis donc mes recherches et aperçus alors un meuble auquel je n’avais jusque là prêté attention. Il s’agissait d’un petit coffre posé dans un coin de la baie vitrée. Intrigué je m’approchai et l’ouvrai. Une odeur de renfermé me monta aussitôt aux narines ainsi qu’une faible volute de poussières et j’eus un léger mouvement de recul pour m’éviter d’éternuer. Hélène s’approcha à son tour et se pencha par dessus mon épaule. Le coffret était rempli à ras bord, en majorité de feuilles de papiers griffonnées. J’en tirai une pleine poignée et les posai sur la table basse afin de les examiner. Il s’agissait de dessins d’enfant. La plupart aux crayons de couleurs, mais certains avaient été réalisés aux feutres comme en attestaient les nombreuses bavures. Nous échangeâmes un rapide coup d’oeil amusé et nous installâmes dans le canapé en tirant le coffre sur le tapis.
Les premiers dessins représentaient la cabane sous une épaisse couche de neige. Puis la météo semblait s’améliorer au fur et à mesure que nous progressions vers le fond de la boîte. J’en extirpai une dizaine d’autres sur lesquels le soleil, (un épais rond jaune en tous les cas) irradiait de longs traits fins. Hélène esquissait un sourire et fit un commentaire auquel je ne prêtai attention, fasciné par ce que je voyais. Après quelques dessins, je constatai que le soleil se faisait à nouveau plus rare, les feuilles des arbres tombaient jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus aucune et bientôt la neige fut de retour, nous venions sans doute de passer en revue une année complète de visiteurs, avec ses quatre saisons mais Hélène me fit remarquer que l’on était en mai et que la neige était encore partout donc rien n’était moins sûr.
Nous atteignîmes le fond du coffre et une nouvelle surprise nous attendait. Un instrument de musique y était entreposé. Il s’agissait selon toute vraisemblance d’un cor. À la simplicité de ses matériaux de fabrication, mais aussi le fait que de par sa conception il ne devait pas être facile d’y jouer plus d’une note ou deux, nous tombâmes d’accord pour dire que c’était sans nul doute un modèle de chasse ou militaire. Il y avait aussi quelques vieilles feuilles de papier musique, gribouillées d’une main hâtive, qui traînaient au fond de la caisse.
Hélène qui jouait du piano – de manière plus qu’habile soit dit au passage – et savait lire les notes y jeta un bref coup d’oeil.
― Cela n’a pas l’air d’être du Beethoven dis donc… (Elle haussa les sourcils et j’observai ses yeux courir la feuille de gauche à droite avec envie) « C’est même un peu toujours pareil, comme si quelqu’un avait transposer un morceau de techno sur une partition ou…
― Du morse ?
Cette réflexion l’amusa.
― Oui on peut dire ça…
― Je me demande à quoi cela peut bien servir.
― Musicalement ça n’est pas très bon en tout cas. »
Je haussai les épaules et nous gardâmes le silence un instant ou deux.
Mais si cette petite aparté nous avait quelque peu réchauffé le coeur, le contexte revint vite au galop, s’imposant à nous lorsqu’une nouvelle bourrasque fit trembler les murs de la maisonnette et le froid s’immiscer dans nos anoraks. Le combustible venait toujours à manquer.
Je cherchai le regard d’Hélène qui esquiva le mien avec gêne. Je finis par prendre la parole:
― Ce sont de vieux dessins L’, personne ne nous en voudra si on en utilise quelques uns pour se réchauffer. »
Elle hausse platement les épaules. Je raclai le fond du coffre pour en sortir les plus vieux, – ces dessins là étaient à présent quasi-illisibles; l’encre avait jauni avec le temps et tous s’étaient revêtus d’une teinte sépia des plus inesthétiques. Je les froissai jusqu’à obtenir de petites boules et les disposai dans le poêle un peu partout entre les buches. Avec la dernière liasse je fis une sorte de cône que j’enflammai à l’aide une allumette et m’en servis pour allumer les autres. Cela fait elle alla rejoindre des petites soeurs dans l’âtre.
À notre grande joie le feu ne se fit pas nonchalant et prit très vite.
J’ignore si les composés chimiques de l’encre y furent pour quelque chose mais se faisant, j’observai d’étranges lueurs se former et disparaître au milieu des flammes, lesquelles prirent par instants des couleurs stupéfiantes; non pas seulement vert comme lorsque l’on fait brûler du cuivre, mais aussi violette, et bleu, comme si sa température avait subitement fait un bon en avant, observation qui n’avait bien sûr aucune base rationnelle. Cela devait être la fatigue et tous les tracas qui m’avaient harassé durant le jour, encore que techniquement il n’était pas fini et s’étendait même au dehors comme au beau milieu d’une après-midi…
Bien sûr, je ne pouvais m’empêcher de penser au fond de moi que c’était une chose singulière que de brûler des dessins d’enfants et ce, même si dans un but aussi pragmatique que se réchauffer.
Je fus pour tout dire, surpris de la vitesse à laquelle l’atmosphère se réchauffa après que le poêle eut été mis en marche. Hélène qui s’était entre temps blottie dans le canapé sous une multitude de plaids sortit le bout de son nez.
― Il fait déjà meilleur. » Souffla-t-elle.
J’acquiesçai en silence et enflammai une nouvelle allumette pour faire un peu de lumière dans la pièce. De nombreuses bougies étaient disposées un peu partout comme la cabane ne disposait pas d’électricité. Il ne me fallut que quelques minutes pour toutes les allumer et bientôt, une douce et chaleureuse lueur irradiait les lieux.
Au dehors, la tempête suivait son cours. Il allait être bientôt minuit et l’on devinait encore sans mal la forme des arbres, comme celle de l’étang que j’avais aperçu en engageant la voiture dans l’allée, à moins d’un kilomètre de la cabane.
Après m’être assuré que les buches avaient bien pris, j’enfilai mes bottes et me résignai à ressortir pour aller chercher nos affaires. J’ouvris la porte de la cabane et sans réfléchir m’engouffrai dans cette nuit aux yeux vides qui me contemplai et à laquelle je ne semblais pouvoir échapper. La faible obscurité me permit de voir que l’espèce de petite cour remplie d’arbres et de racines qui raccordait les différentes parties de la propriété n’était désormais plus qu’un champ de boue dégoulinant. Je m’empressai de descendre la petite côte menant à la voiture et fus soulagé de voir que celle-ci ne s’était pas complètement embourbée. J’ouvris le coffre pour tâcher d’extraire aussi vite que possible nos deux petits sacs contenant trousses de toilettes, argent et autres objets précieux ou de première nécessité. J’envisageai un instant de ramener nos deux gros sacs de voyage mais à ce moment précis, la foudre ne dut tomber bien loin (Peut-être sur le lac ?) comme j’entendis son vacarme assourdissant dans la même demi-seconde où son éclair illumina le paysage et ce détail – au delà de l’effroi qu’il était censé provoquer, et qui ne faillit d’ailleurs à sa tâche – eut un autre effet plus inattendu; celui de la surprise, car pendant que l’éclat lumineux avait embrasé les alentours j’avais cru voir quelque chose, au loin sur la route, à peut-être quatre ou cinq kilomètres. Je voulus d’abord attendre le prochaine éclair pour en avoir confirmation, mais les assauts de la pluie eurent tôt fait de me faire changer d’opinion et en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire j’étais de nouveau à l’abris, dans notre petite cabane.
En entrant je m’attendis à être enlacé par la douce chaleur que nous avions obtenu à si grand prix mais pour une raison mystérieuse le froid avait de nouveau pris possession des lieux. Je m’avançai dans la pièce principale et trouvai Hélène toute pelotonnée et endormie sous ses plaids. Dans l’âtre, seule une petite flamme vacillait à présent et les buches que j’y avais glissées étaient revenues à l’état de cendres. Sur l’instant je ne prêtai pas attention à ce détail étrange. (Il ne devait en effet s’être écoulé qu’une poignée de minutes depuis ma sortie). Et sans y penser, dans l’abîme de mon esprit je dus trouver une explication rationnelle… la trappe d’appel d’air que j’aurais sans doute laissée trop ouverte, accélérant de ce fait la combustion, par exemple.
Je me servis du tisonnier pour repousser les restes de buches au fond de l’âtre et en choisis trois nouvelles, d’aspect sec et solide. J’eus alors une hésitation. N’ayant toujours pas mis la main sur des allume-feu ou du papier journal je me trouvai une fois de plus obligée d’aller piocher dans la réserve à dessins. Je raclai le fond du coffre pour en tirer les plus anciens, les froisser et les mis dans l’âtre: ceux-ci étaient déjà nettement moins jaunis que les précédents. Mon malaise s’accentua un peu. Mais c’était là une question de survie. Moins d’une minute plus tard, un joli feu dansait à nouveau au milieu de la pièce. Ses teintes chaudes l’illuminaient en contrastant de façon agressive avec le bleu gris et glacial qui dominait l’extérieur. A de nombreuses reprises durant l’heure qui suivit je vis les flammes vaciller et je dus relancer le feu en bourrant le poêle d’autres dessins. Certaines des buches devaient être encore trop humides et avaient des difficultés à prendre. Il était à peu près une heure du matin lorsque je fermai définitivement l’arrivée d’air, jugeant que la température serait suffisante pour passer la nuit.
J’ignorais l’heure qu’il pouvait être. La relative clarté – ou pénombre – selon le point de vue adopté, me perturbait au plus haut point et me faisait perdre mes repères.
Au dehors, la tempête s’époumonait toujours et semblait pouvoir continuer encore des heures durant. À travers le rideau de pluie qui s’abattait sur la baie vitrée, je devinai encore – bien qu’à grand-peine – les silhouettes chétives des sapins ballottées en tout sens. Je n’osais imaginer l’état dans lequel nous allions retrouver la petite cour le lendemain.
Je laissai cette pensée errer un moment dans mon esprit puis sombrai peu à peu dans un sommeil diurne.
DEUXIÈME PARTIE
Nous nous réveillâmes le lendemain sur le coup de onze heure. Le soleil devait être déjà haut dans le ciel. Ses rayons filtraient à travers l’épais rideau que j’avais rabattu sur la grande baie vitrée, cela afin de retenir au mieux l’obscurité de la pièce. Le poêle avait dû s’éteindre quelques heures plus tôt comme je ne voyais plus que cendres et poussière à l’intérieur. La chaleur s’était dissipée et il faisait froid dans la pièce.
Pour le reste, l’accumulation de fatigue devait expliquer cette grasse matinée involontaire. Je frissonnai en quittant le lit et ses chaudes couvertures. Hélène émit un grognement lorsque la fraîcheur du matin s’immisça à la place que je venais de libérer et je sus à la manière dont elle s’était lovée sous la couette qu’elle paresserait encore une dizaine de minutes au lit. Je me dirigeai vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner et ma seconde pensée fut d’aller me rendre compte des dégâts que la tempête avait dû provoquer au dehors. Crainte qui bien sûr – avec la nuit qui venait d’avoir lieu – était on ne peut plus légitime.
Je fouillai la cuisine, trouvai une casserole, y mis de l’eau à chauffer et m’empressai d’enfiler mes bottes pour jeter un oeil à l’étendue des dégâts.
J’ouvris la porte donnant sur la petite cour. Une légère brise vint aussitôt me caresser le visage. Je la sentis passer entre chacun des poils de mon visage, résultat d’une semaine sans rasage. Son souffle était agréable et vivifiant. Le ciel était d’un bleu uni sans la moindre trace de nuages. La forêt était toujours à sa place, comme si rien n’était venu troubler l’immobilisme, la plénitude des lieux depuis une éternité. Les branches des sapins se mouvaient sous la brise avec lenteur et onctuosité, comme des algues marines à travers la surface de l’eau.
Surpris de ne trouver aucune séquelle visible de la tempête, je descendis la petit cote jusqu’à l’allée où nous avions garé notre voiture. Celle-ci s’y dressait toujours fièrement, sans aucune trace d’eau, d’épines ou de pommes de pins coincées dans les essuies-glaces. Stupéfait, mais aussi soulagé, je mis cela sur le compte du vent qui aurait sans doute tout emporté avec lui (et séché l’auto au passage). Je remarquai à ce sujet que les buches empilées sous l’abris à bois devait avoir subi le même traitement comme elle n’affichait désormais plus aucune trace d’humidité. « Prête à l’emploi comme aurait dit l’autre ».
Pressé d’annoncer la nouvelle à Hélène je remontai la petit cote au pas de course.
Lorsque j’entrai dans la cuisine je l’y trouvai les bras croisés, son plaid sur le dos.
« Tu mets de l’eau sur le gaz et tu t’en vas ?
Derrière elle j’aperçus deux tasses de café. Une douce fumée en émanaient.
― Le petit déjeuner est déjà prêt ? »
Elle acquiesça en allant s’asseoir à la table où je vis deux assiettes remplies d’oeufs pochés et de bacon grillé.
― Tu n’as pas traîné dis donc, je ne suis même pas sorti cinq minutes… »
Elle leva les yeux au ciel et m’interrompit:
― Toi et ta notion du temps… Mange plutôt, il ne manquerait plus que cela refroidisse. »
Je ne me le fis pas dire deux fois et avalai avec ma hâte habituel ce copieux petit déjeuner. Hélène me jeta un regard désapprobateur.
― Je te préviens que nous n’avons plus rien d’autre à manger donc faisons un gros brunch ce matin puis il faudra trouver quelque chose pour ce soir et les autres jours ».
Il y avait une pointe d’angoisse dans sa voix. Je la dissipai d’un geste de la main:
― Ne t’en fais pas. »
Elle m’interrogea du regard et je me plus à faire durer un instant le suspense.
« Hier soir j’ai aperçu une sorte de hameau.
― Un hameau ? Loin d’ici ?
― Non, peut être quatre ou cinq kilomètres. » Dis-je en me levant de table pour rejoindre la pièce principale.
Celle-ci baignait à présent dans la lumière comme Hélène avait ouvert le rideau en grand. Je fouillai une étagère où il me semblait avoir vu la veille une paire de jumelles. Elle s’y trouvait bien, coincée entre deux livres, couverte de poussières, mais opérationnelle. Je les réglai à ma vue et les braquai à l’horizon.
« Tu vois quelque chose ? » Me lança-t-elle depuis l’autre bout de la cabane.
Je balayai le paysage pour la seconde fois, commençant à songer que la fatigue avait pu me jouer un tour lorsque j’aperçus au loin le toit d’une habitation, puis une autre, et encore une autre, surgies de nulle part comme des champignons. En tout une vingtaine de maisonnettes à peine plus grande que la notre, perdues mais blotties au milieu de cette immensité de glace et de sapins. J’esquissai un sourire en lui tendant la paire de jumelle
« Je me demande pourquoi notre hôte ne l’a pas mentionné dans son annonce. C’est tout de même un repère plus commode », murmura-t-elle d’une voix pensive.
Je haussai les épaules. La question m’avait en partie occupée l’esprit la veille mais forcé d’admettre que je n’étais pas davantage avancé sur ce point après une nuit de réflexions subliminales.
― Je vais prendre la voiture et aller y faire un tour, dis-je. Ça serait bien le diable qu’il n’y ait pas une épicerie ou un endroit où se réapprovisionner, je ne pense pas que les gens fassent l’aller-retour jusqu’à Kiruna chaque fois qu’ils veulent acheter une baguette. Tu m’accompagnes L’ ? »
Elle secoua la tête.
« Vas-y tout seul, je vais en profiter pour faire un peu de rangement. »
(Elle et son rangement…)
Je ne voyais pas ce dont elle pouvait bien parler puisque nous n’avions que deux valises à moitié pleine par volonté de voyager léger et qu’il suffisait d’en vider le contenu dans une armoire… mais je ne cherchais pas à approfondir. Lubies féminines sans aucun doute et aussi très certainement d’être seule un moment dans cette ravissante cabane pour faire un peu de cocooning (ce qu’en revanche je ne pouvais que difficilement lui reprocher). Les femmes ont en effet je trouve, bien plus que les hommes, cette tendance à s’approprier les lieux qu’elles visitent en les marquant de leur empreinte. Par petites touches accoutumantes: changer la place d’un meuble, intervertir deux tableaux, remplacer un bibelot etc…
Je pris le temps de savourer mon café et mes tartines comme je n’étais pas sûr de pouvoir en reprendre de sitôt et Hélène dut avoir la même pensée comme je la vis faire de même.
« C’est curieux que cette maison n’ait pas l’électricité mais l’eau courante. » Dit-elle en croquant dans une pomme.
― Ce n’est pas parce qu’il y a un robinet que nous avons l’eau courante ».
Elle leva les yeux au ciel.
― Ne fais pas l’idiot tu m’as bien comprise. »
Je souris avant de reprendre:
― En sortant j’ai repéré tout un faisceau de tuyaux en plastique, je suppose qu’ils vont puiser à une source, en amont. »
Elle acquiesça pensivement.
― J’espère que l’eau est potable au moins. »
Cette réflexion m’arracha un sourire.
― Si celle-ci ne l’est pas alors je ne vois pas laquelle pourrait prétendre l’être ».
A travers l’imposante baie vitrée passaient les rayons du soleil et nous couvaient de leur chaleur protectrice. Il devait être midi. Je quittai mon siège et me dirigeai vers le sas pour enfiler mes chaussures et me vêtir plus chaudement.
« Ne tarde pas trop » me lança-t-elle tandis que je fermai la porte derrière moi.
Le craquement de la neige sous mes pas devenait agréable maintenant que je m’étais chaussé d’épaisses chaussures de marche. Je descendis la cote menant à la voiture. Le début d’inondation dont nous avions été témoin la veille avait pris fin et la rigole retrouvée son lit sans plus d’histoires. Elle s’écoulait à présent avec entrain depuis l’amont de la vallée et sans doute jusqu’au grand lac visible depuis la cabane. C’était elle pensais-je qui était venue ce matin arroser notre café.
Je me tournai vers la voiture et sans comprendre d’abord pourquoi, abandonnai le cour de mes pensées. Quelque chose d’indéterminable avait attiré mon attention. Je fronçai les sourcils et m’approchai du véhicule. Le malaise était survenu alors que je m’étais apprêté à prendre place à l’intérieur. La poignée de la portière. Je la trouvais basse. Plus basse que de coutume et même si je ne l’avais conduit que pendant une brève semaine, la Skoda et moi avions tissé un certain nombre d’automatismes dont je me voyais ici pris en défaut. Je fis un pas ou deux en arrière afin de mieux comprendre et la réalité me frappa alors. Je restai une dizaine de secondes sans bouger, encore que cela put être une vingtaine ou une trentaine, à vrai dire je n’en sais rien. La raison pour laquelle j’avais été subitement interpellé était que la voiture était plus basse que d’habitude, disons d’une quinzaine de centimètres, et cela s’expliquait d’une manière aussi simple qu’embarrassante: les pneus étaient à plat. Les quatre autant que je pouvais en juger puisque la garde au sol était uniforme. Je fis le tour pour m’en assurer et poussai un juron après être revenu à ma position initiale. Alentour, la nature semblait me contempler, retenant son souffle, dans l’attente de ma prochaine action. Je poussai un soupir en m’agenouillant dans la neige, à hauteur de l’essieu avant. Difficile de voir ce qui avait pu provoquer la crevaison, en apparence le pneu semblait en bon état, de même que la jante ne laissait voir aucune déformation, ce qui excluait tout choc brutal. De toute manière je ne me rappelais pas avoir ressenti de secousse particulière en arrivant la veille. D’un autre côté je n’étais alors pas au volant et la tempête avait pu détourner mon attention. Il faudrait que je demande à Hélène. L’enjoliveur avait bien quelque rayures mais les nombreux kilomètres que nous avions parcouru sur des routes en terre et parsemées de cailloux pouvait aisément les justifier. Je fis le tour du véhicule pour examiner chaque pneu mais aucun ne portait de trace de déchirure violente ou autre. A en juger les témoins d’usure, ils venaient même d’être changés il y a peu. Je me redressai en m’époussetant les mains sur le pantalon et secouai la tête. Au même moment j’entendis le déclic d’une porte et Hélène apparut sur la terrasse de la cabane surélevée par des pilotis.
« Qu’est ce qui se passe tu n’es pas encore parti ? »
Elle n’avait pas même élevé la voix et je fus surpris de l’entendre aussi distinctement. Le silence était ici porteur du moindre son inhabituel et le décuplait à travers l’immensité.
« La voiture a un problème. » Lui lançai-je, renonçant à mettre les mains en porte-voix.
« Qu’est-ce qu’elle a ? »
« Les pneus sont crevés. »
Même à cette distance je n’eus aucun mal à la voir froncer les sourcils. Elle rentra dans la cabane et en ressortit une paire de bottes aux pieds. Je la vis descendre l’escalier en bois menant de la terrasse à la cour et avancer à tâtons dans l’épaisse couche de neige à cet endroit encore intact.
― Qu’est-ce qui s’est passé ? »
Je haussais les épaules.
― Je n’en sais rien, il n’y a aucune trace anormale, c’est comme s’il y avait un tout petit trou quelque part et qu’il s’étaient dégonflés lentement.
― Ils n’étaient pas comme ça hier en arrivant.
― Je ne crois pas mais on a aussi pu crever plusieurs kilomètres en amont et continuer sans se rendre compte de rien; ils auront fini de se dégonfler pendant la soirée .
― Tu n’as rien remarqué d’anormal hier en allant chercher nos valises ?
― Non mais avec la tempête je ne sais pas si j’y aurais vraiment fait attention.
― Et ce matin, tu es sorti aussi ?
― Oui mais je ne suis pas allé jusqu’à la voiture, je l’ai juste vu de loin ».
C’était un mensonge. J’étais en fait allé jusqu’à l’auto.
― Et tu n’as rien remarqué ? »
Difficile de dire pourquoi mais je ne voulais pas qu’elle commence à me cuisiner sur la chronologie des choses.
― Non mais à cette distance je n’aurais pas pu, c’est à peine si on distingue le logo Škoda à l’avant. »
Je soupirai et Hélène s’immergea dans ses pensées un court instant.
― On a forcément une roue de secours dans le coffre ».
― Une oui, pas quatre…
― Les quatre pneus sont à plat ? S’exclama-t-elle en faisant le tour du véhicule.
― J’en ai peur.
― C’est bizarre. Je n’ai jamais vu une voiture perdre simultanément ses quatre pneus. C’est comme si l’on avait roulé sur l’une de ces herses que les flics mettent en travers des routes lorsqu’ils recherchent quelqu’un. »
Je ne sus quoi lui répondre. Effectivement cela paraissait incroyable que nous ayons pu les crever tous les quatre simultanément.
― Peut-être que la crevaison n’est pas arrivé en même temps, peut-être qu’il y avait des choses qui trainaient sur la route et que nous les avons perdus l’un après l’autre hier soir en arrivant. » Lâchai-je enfin.
― De quel genre de choses est-ce que tu veux parler ?
― Je n’en sais rien… des cailloux, pointus. Ce n’est pas ce qui manque ici.
― La route n’est pas si mauvaise, et nous avons connu bien pire comme revêtement au cours de la semaine. »
― Il suffit de rouler au mauvais endroit au mauvais moment. Il suffit d’un mauvais caillou. » Dis-je sans trop y croire.
― Bon mais c’est fait maintenant, inutile de retourner la chose dans tous les sens. Il ne faut pas que cela nous gâche le voyage.
― C’est à dire que sans voiture on risque d’avoir quelques petits problèmes pour se déplacer, et je suis sûr que le loueur va me chercher des noises. »
― Mais non, ne te stresse pas avec ça, tu as pris le forfait complet avec assurance maximale, tous ces détails sont pris en charge. »
― Certes, mais maintenant nous sommes coincés dans un trou au fin fond du cercle polaire et à cinquante kilomètres de la ville la plus proche. Ça, ce n’est pas pris en charge. »
― Et le village que tu m’as montré ? »
― J’ai dit ville, pas hameau. Ils n’ont même pas l’air d’avoir de station essence, heureusement que j’ai pensé à faire le plein en quittant Kiruna.
Hélène s’approcha de moi et m’enlaça dans ses bras avant de chercher mon regard.
― Profite, ce n’est pas grand chose d’accord ? On va passer un coup de fil au loueur et il enverra un garagiste. »
― Oui en parlant de ça mon téléphone est presque à plat et comme tu le sais on n’a pas l’électricité ».
― Ce n’est pas grave, le mien en a encore et au pire on pourra se brancher dans la voiture. Elle ne roule plus mais la batterie fonctionne toujours que je sache. »
Je soupirai une fois encore. Tout cela était très censé.
Comme souvent dans les couples, ce genre de situations était en train d’engendrer une répartition des rôles assez bipolaire. Dans cet ordre d’idée j’avais beau avoir opté depuis quelques minutes pour celui de l’éternel pessimiste, j’étais reconnaissant à Hélène de prendre tout ceci avec légèreté. Il en était souvent ainsi entre nous: lorsque l’un déprime, l’autre rayonne de joie: principe élémentaire de conservation d’énergie, la pendule de Newton. Lorsque l’un s’approche, l’autre s’éloigne.
Je l’enlaçais à mon tour.
« Tu as raison. Je vais me rendre à pied au village, chercher de quoi manger, et voir ce que l’on peut faire.
― Vas-y, je vais appeler le loueur et préparer le repas de ce midi avec ce qui nous reste de nourriture ».
Je m’équipai chaudement en vue de la marche qui m’attendait; le village ne devrait pas être bien difficile à trouver – il suffisait en fin de compte de suivre l’unique route – mais j’estimais toute de même sa distance à quatre ou cinq kilomètres.
J’enfilai écharpe, gants et bonnets et quittai la propriété. Le caractère rectiligne de la route avait quelque chose de profondément déprimant comme il semblait impossible d’en atteindre le bout. Sur ma droite, du côté de la cabane, s’étendait au nord une forêt de conifères, profonde et silencieuse, tandis que sur la gauche, pointant en direction du sud, l’océan végétal se faisait déjà bien plus clairsemée et à l’horizon s’érigeait la silhouette arrondie de la chaîne de montagne qui nous enclavait dans cette vallée. Vue d’ici elle ressemblait à un raz-de marée cyclopéen, figé dans le temps, mais prêt à nous engloutir sans la moindre hésitation. Nulle trace en revanche du lac que j’avais aperçu depuis la terrasse de notre cabane. Sans doute se terrait-il trop profondément au sud et les cimes des arbres se dressaient bien trop haut pour que je puisse l’apercevoir. Je me retournai pour voir la cabane bientôt réduite au loin à l’état de miniature. De l’autre côté les toits du village pointaient peu à peu et je supposai avoir parcouru la moitié de la distance.
Sur ma droite je sentis alors un frémissement dans la végétation.
Je tournai brusquement la tête et vis un groupe de rennes paraître à la lisière des bois. Ils m’observèrent d’abord d’un oeil alerte, comme pour me jauger, puis, estimant que je ne devais pas constituer une menace majeure, s’avancèrent sur la route. J’en vis ainsi cinq ou six s’extraire d’entre les branches des arbres, provoquant sur leur passage la chute des neiges qu’elles pouvaient encore supporter. Un voile scintillant au soleil comme du sucre glace saupoudré. Les plus gros spécimens en entraînant bien sûr davantage que les petits. Le groupe traversa la route d’un pas lent et flegmatique, quoi que sans me quitter du coin de l’oeil. Je remarquai au passage que pour la première fois depuis notre départ d’Umea, ces animaux ne portaient aucun collier ou marque d’identification quelconque. Il devait s’agir de rennes sauvages. J’avais interrompu ma marche le temps de leur traversée, comme je souhaitais profiter de cette vision sans risquer de leur faire peur, et je ne repris la route qu’après avoir vu les deux derniers, un petit suivi d’un gros – la mère sans aucun doute – disparaître dans les fourrés aux avant-postes du bois. Toute la scène s’était déroulée sous un magnifique ciel bleu et sans nuage, aussi me surpris-je à penser que tout n’était après tout pas si mal, Hélène allait appeler le loueur qui nous enverrait un dépanneur, pendant ce temps j’achèterai de la nourriture au village, sympathiserai peut-être même avec quelques habitants, et au bout du compte tout rentrerait dans l’ordre. Nous allions enfin profiter de notre temps ici.
Il ne devait plus me rester qu’un kilomètre à parcourir comme je distinguai à présent sans mal le groupement de maisons qui constituaient le hameau. Sans surprise elles étaient faites de bois, pour la plupart peint en rouge, même si quelques unes s’étaient payées l’excentricité d’afficher d’autres couleurs. En me rapprochant je compris qu’ils devaient s’agir de commerces ou en tout cas de points « d’intérêts ». Je ne distinguais en revanche aucune trace de vie ou même d’activité et s’il n’y avait eu ce léger filet de fumée s’échappant des conduits de certaines cheminées, j’aurais pu en déduire que le village était désert. J’atteignis bientôt sa lisière, un petit panneau enfoncé dans la neige – et pour tout dire presque entièrement recouvert par elle – m’apprit que le hameau s’appelait « Vangerström » et que sa population humaine était d’une centaine d’âmes. (Je prends la peine de préciser « humaine » car si l’on comptabilisait les rennes ou animaux d’élevage, ce chiffre devait semblait bien pouvoir être multiplié par quatre ou cinq !) C’était du moins mon impression après ma singulière rencontre sur la route; mais aussi à cause des étables et poulaillers qui m’apparurent bientôt un peu plus loin, suivis de caquètements et autres bruits de bétail.
Je m’enfonçai un peu plus dans le hameau, suivant la route qui, avant d’y pénétrer, tournait brusquement sur la droite, rompant de ce fait la perspective.
Je passai quelques maisons. Les volets étaient ouverts mais personne ne se trouvait au balcon, ou même à l’intérieur autant que je pus en juger. Je poursuivis jusqu’à atteindre son autre extrémité, ce qui ne me prit qu’une minute ou deux. La route s’extirpait des maisons pour reprendre son cheminement vers l’ouest, sereine et droite comme seule les routes parcourant de si grands espaces peuvent l’être. Je ne pouvais voir où elle s’échouait. Au loin, même les montagnes semblaient minuscules. Combien d’âmes pouvaient encore y vivre et combien de forêts, combien de lacs et de kilomètres pouvaient-on encore y compter ? Tout cela je pense, nul n’aurait pu le dire. Nous n’étions pas encore au bout de la route que déjà les limites du monde se laissait entrevoir. Je les devinais là-bas, quelque part derrière ses montagnes colossales et pourtant si insignifiantes vues d’ici. Les rennes, seuls témoins de ces étendues glacées, les sillonneraient jusqu’à la fin des temps, foulant les neiges éternels de leur pas flegmatique.
J’étais en train de sombrer dans mes pensées lorsqu’un bruit m’en tira.
Au milieu du silence environnant, il émergea presque comme une fausse note.
Il n’était pas brusque ou soudain. Il avait simplement dû monter de manière progressive, jusqu’à atteindre une intensité suffisante pour me sortir de ma rêverie. C’était un bruit de pas dans la neige. Je me tournai pour découvrir une haute et lourde silhouette confortablement emmitouflée sous un épais manteau. C’était un homme. Son visage n’était pas visible sous le bonnet et la cagoule qu’il portait. Je le vis s’arrêter à quelques mètres de moi et commencer à les ôter. Il s’agissait d’un fort gaillard à n’en pas douter, mais je me rendais bien compte que son imposante stature ne pouvait s’expliquer que par sa corpulence. Il devait porter en dessous de son manteau une multitude d’autres couches, achevant de lui donner cet aspect difforme, ou en tout cas cette irrégularité entre les jambes – déjà lourdes et épaisses – et le haut, pour le coup titanesque. L’homme ôta son bonnet et je vis apparaître une épaisse tignasse blonde, bientôt suivi d’un visage après que le masque fut tombé. Ses yeux bleu clair furent le premier détail frappant du visage affable qui se révéla bientôt à moi. L’homme sourit en s’approchant, la main tendue, et sans trop savoir ce que je faisais – mais me laissant porter par mon instinct – je m’avançai en même temps pour la serrer. Je sentis cette étreinte rugueuse et ferme propre aux gens coutumiers du travail manuel et lui rendis son sourire tout en conservant mon air interrogatif pour lui donner l’initiative de la parole.
« Vous êtes le monsieur de la cabane ? » L’entendis-je me demander dans un anglais approximatif mais guère plus mauvais que celui que je devais pratiquer.
J’acquiesçai en faisant l’étonné, mais cela ne fut à vrai dire pas bien difficile comme je l’étais en fait au plus haut point.
― Touché. C’est bien moi. Le propriétaire vous a prévenu de notre arrivée ?
― Non, mais je vous ai vu passer dans la rue depuis ma boutique. Je me suis dit, « Tiens je ne connais pas ce visage », cela ne pouvait être que vous.
― Est-ce vous qui aviez ouvert la cabane en prévision de notre arrivée ? »
Il ne parut pas très bien saisir le sens de mes paroles et m’observa d’un air pensif.
― La cabane ? Oh non, elle reste ouverte en permanence, pas de problème.
Je n’étais pas certain d’avoir bien compris le sens de ces derniers mots « pas de problème », mais j’acquiesçai néanmoins énergiquement.
― Bien.
― Je ne me suis pas présenté, je m’appelle Sven Ekberg. Je travaille à l’épicerie.
― Enchanté, Syd Vesper.
― Ce n’est pas un nom habituel. De quelle origine est-il ?
― Aucune en particulier.
Il m’observa en acquiesçant mais je vis bien à en juger son air décontenancé qu’il n’avait pas du me comprendre.
― Vous avez fait bon voyage jusqu’ici ?
― Excellent oui, la route n’est pas très compliquée », dis-je en riant.
― D’où êtes-vous partis ?
― Umea.
― C’est une longue route…
― Oui, nous l’avons faites en une semaine pour prendre le temps de visiter.
― Beaucoup de choses à voir entre ici et Umea…
J’acquiesçai en prenant un air affable. Notre conversation avait la platitude courtoise d’une discussion entre deux individus ne parlant la même langue mais je voyais bien que mon interlocuteur était d’une cordialité sincère. Fatalement nous finîmes par dévier sur la pluie et le beau temps:
― Sacrée tempête hier soir, lui lançai-je. Est-ce fréquent dans le coin ? »
Il m’observa en fronçant les sourcils.
― Une tempête vous dites ? »
― Oui, hier soir. »
De nouveau il ne parut pas bien saisir ce dont j’étais en train de parler. Mon anglais pouvait-il être aussi mauvais ?
« Elle a commencé alors que nous avions quitté Kiruna, sur la route pour venir jusqu’ici. »
― Vers quelle heure ? »
J’avais été ces derniers jours assez perturbés par l’interminable course du soleil donc je n’étais plus très sûr de mes références temporelles. Je fouillai dans ma mémoire.
― Il me semble qu’il devait être environ vingt heures.
Il marqua une nouvelle pause.
― C’est étrange, j’étais encore dehors à cette heure et cela ne m’a pas marqué. »
Je me demandais si c’était pour mon interlocuteur une façon de me signifier que dans ces contrées, les habitants ne subissaient pas la météo de la même manière qu’ailleurs car coutumiers de la rudesse du climat.
― Les arbres tremblaient en tout sens, il y avait des éclairs qui déchiraient le ciel. »
Il m’observa en continuant d’acquiescer. À présent je n’étais plus très sûr de l’interprétation à avoir.
― On n’a pas eu de tempête telle que vous la décrivez depuis un moment, la dernière c’était il y a plusieurs mois, quelque chose comme ça.
Il avait l’air sincère. Je choisis d’éluder le sujet en passant à autre chose:
― Vous me disiez travailler à l’épicerie ?
Son visage s’éclaircit de nouveau en m’entendant parler de son commerce.
― Oui, elle se trouve vers le centre de la ville ». (Je réprimai un sourire en l’entendant utiliser ces mots, autant la « ville » que son « centre »)
― J’ai dû passer devant sans y faire attention.
― C’est la maison en bois verte.
Je me souvenais effectivement être passé devant une bâtisse semblable.
― Moi et mon amie nous restons une semaine à la cabane donc attendez-vous à nous voir souvent.
― Bien sûr, si vous avez besoin de quelque chose n’hésitez pas ». Il marqua une pause et laissa échapper un sourire. « À vrai dire je suis le seul commerce de Kiruna jusqu’à la frontière Norvégienne. »
Je ne pris la peine de masquer ma surprise.
― Le seul commerce ? Tout le monde vient donc chez vous ?
― C’est à peu près cela. Je vends tous les produits habituels, puis je m’occupe de prendre les commandes particulières de chacun lorsque je vais me réapprovisionner à Kiruna. Vous avez dû voir le gros pickup noir ? C’est le mien. »
Je ne me souvenais pas du gros pickup noir mais je saluais le hasard d’avoir conduit cet homme à venir me parler. Dans ma situation présente je n’aurais pu espérer mieux.
― C’est une chance que vous soyez venus à ma rencontre, je venais justement faire quelques emplettes.
― Vous êtes en face de la bonne personne, suivez-moi ». Ce que je fis donc.
« … Qu’est-ce qu’il vous faudra au juste ? »
― Les produits de base seulement. Voyez-vous je suis un peu limité par le poids comme je suis venu ici à pieds.
― De la cabane ?
― Notre voiture a eu un problème, les pneus ont crevé.
― Crevé ? C’est malheureux mais cela arrive parfois dans ce coin du pays. Les routes ne sont pas parfaites comme vous avez dû vous en rendre compte. Une pierre un peu trop pointue, et hop ». (Il imita le bruit d’un pneu qui se dégonfle). C’est l’accident ! »
À ce stade de notre rencontre je ne jugeai pas utile de rentrer dans les détails et lui expliquer que les quatre pneus ayant crevés, cela faisait tout de même une sacrée malchance.
― Mon amie doit être en train d’appeler le loueur au moment où nous parlons, Ils vont envoyer un dépanneur et tout sera vite réglé.
― Un dépanneur ? Mais on a tout ce qu’il faut ici, qu’est-ce que vous avez comme auto ?
― Une Skoda Octavia.
― Une voiture de ville », dit-il pensivement.
Je ne dis rien même si je trouvai en fait singulière l’idée que l’on puisse considérer notre voiture comme une citadine, mais c’était peut-être le cas dans ce coin du pays.
Nous nous arrêtâmes devant la maison verte que j’avais vaguement remarquée à l’aller. Je me rassurai moi-même en constatant qu’elle ne portait aucun signe extérieur annonçant qu’il s’agissait d’une épicerie – ou même d’un commerce quelconque -, je n’étais donc pas aussi étourdi que je l’avais d’abord pensé.
En dehors de sa couleur elle ne se détachait en rien du reste des habitations.
― C’est ici », m’annonça Sven d’une voix chantante.
Je le suivis à l’intérieur d’un pas timide comme j’avais davantage l’impression de pénétrer chez quelqu’un que dans un magasin. (Ce qui m’avait d’ailleurs tout l’air d’être techniquement le cas).
En entrant, mon nouvel ami me présenta à sa famille qui était en train de déjeuner dans la cuisine. Je les saluai dans un Suédois plus qu’approximatif. Les enfants m’adressèrent de grands signes de la main tandis que sa femme, une grande blonde aux yeux bleus elle aussi, me gratifia d’un sourire, comme si le fait qu’un étranger pénètre chez eux ainsi était la chose la plus naturelle du monde. Je suivis Sven dans un petit couloir et nous arrivâmes dans une grande pièce pleine d’étagères. Elles étaient remplies de denrées diverses que je parcourus du regard. Je notai la nette dominante en boîte de conserves et fruits secs. À l’autre bout de la pièce, dos à l’unique fenêtre se dressait un imposant comptoir en bois massif. Les rayons du soleil filtraient à travers le carreau et venait y former un carré de lumière. On pouvait y admirer toutes les aspérités du bois.
― Si vous voulez de la viande fraiche dites moi, je la garde au congélateur.
― Non, cela serait trop long de la cuisiner.
Je choisi six ou sept boîtes de conserves diverses, des légumes principalement, et plusieurs sachets de fruits secs.
― Vous n’êtes pas végétarien au moins ? » Me lança Sven d’une voix amusée.
― Non, lui répondis-je sur le même ton. Mais nous n’avons pas l’électricité donc à part faire réchauffer les conserves avec le réchaud…
― J’ai de la viande séchée si vous voulez ?
― Voilà qui m’intéresserait davantage.
Je le vis aussitôt disparaître dans le sol après avoir soulevé ce que j’imaginais être une trappe dissimulée par l’imposant comptoir.
J’en profitai pour passer en revue le reste des produits. Le fond de la boutique était remplie de matériel de pêche. Des hameçons étaient entreposés aux côtés de seaux remplis d’insectes. Un peu plus loin je vis des cartouches de fusil. La plupart de gros calibre et je me demandai le genre d’animal qu’elles pouvaient bien servir à chasser. Durant notre traversée nous n’avions en effet guère aperçu que des rennes en matière de gros gibiers, et la plupart faisaient partis d’élevage. Peut-être y avait-il des ours. Tout cela m’intriguait et je notai dans un coin de ma tête de poser la question à Sven. De douces odeurs de viandes cuites et légumes bouillis me parvenaient depuis la cuisine et je réalisai soudain que la marche m’avait ouvert l’appétit. Les voix des enfants se faisaient entendre faiblement, parfois entrecoupées par celle de leur mère et même si je n’avais aucune idée de ce qui était en train de se dire, je percevais sans mal la sérénité de la conversation, comme tout le reste ici, autant que je pouvais en juger. Je traversai la pièce pour jeter un oeil par la fenêtre. Le carreau était en parti voilé d’un glacis blanc. Le dépôt sans doute laissé par la neige en fondant, comme les traces d’une eau trop riche en calcaire. Dehors, la rue principale du hameau était toujours déserte. Je jetai un oeil à ma montre pour me confirmer qu’il était bien midi. Les familles devaient toutes être à tables à cette heure là. Je finis par m’adosser à la fenêtre afin de laisser le soleil me réchauffer le dos. Sous mes pieds, dans la cave, je pouvais entendre le bruit de pas de Sven, ainsi que des bruits de raclement de couvercles et de tonneaux que l’on déplace. Après quelques instants, j’entendis frapper au plancher et sa voix se fit entendre, bien que fortement étouffée:
« Je vous en coupe pour deux personnes ? »
Je réfléchis une seconde.
« Mettez m’en pour dix, il nous en faut pour la semaine et je suis un gros mangeur ».
Il y eut un moment de silence.
« Combien ? »
Je pliai les jambes pour me rapprocher du plancher et mis les mains en porte voix.
« Une dizaine de tranches, cela devrait nous faire la semaine. »
De nouveau le silence. Pour une raison que j’ignorais il me parut lourd et je doutais que Sven ne m’ait pas entendu comme j’avais presque crié.
« Sven ? »
Après quelques instants sa voix s’éleva de nouveau, chargée d’un embarras très distinct bien que sans doute dilué par la barrière de langue.
« Je crois que je ne vais pas pouvoir vous en vendre autant, je dois en garder en réserve pour les autres familles. »
Je relevai la tête et pris une seconde pour enregistrer l’information avant de me reprendre:
« Oh bien sûr je comprends ! »
Je ne m’étais bien sûr pas attendu à cela mais il était évident que je n’étais pas dans un supermarché.
« Je vais vous en mettre cinq belles tranches et si vous voulez plus de viande je vous emmènerai voir Erikson, un peu plus bas dans le village, le poulailler est à lui, je suis sûr qu’il pourra vous vendre un poulet. »
Je me réjouis à cette idée, nous voyant déjà moi et Hélène mordre à pleines dents dans la bonne chair d’un poulet – on ne peut plus fermier – après l’avoir fait griller sur un bon feu…
« Vous savez déplumer et vider ? »
Je quittai d’un coup le fil de mes pensées.
« Non… Ce n’est pas quelque chose dont je suis très coutumier ».
« Et votre amie, peut-être qu’elle sait le faire, en général les… »
« J’en doute… Je marquai une pause. Bah, ce n’est pas grave je vais déjà vous prendre le jambon.
« Très bien. Je vous coupe de grosses tranches ne vous en faites pas. »
« C’est très aimable à vous. »
« Je vous enlève la couenne aussi ? »
Je m’interrompis, à nouveau pris de court et cherchai l’ironie dans sa voix.
Elle en était dénuée.
« Monsieur Vesper ? »
« Non cela ira bien. »
La trappe s’ouvrit et Sven réapparut derrière son comptoir avec plusieurs belles tranches bien rosies. Il les plaça dans une balance et m’annonça le prix. Je trouvai cela un peu cher mais c’était sans doute le tarif à payer pour de la bonne viande, et le fait d’être un étranger.
― C’est de la viande d’ici ? » Lui demandai-je en humant les tranches avec délice.
― D’ici même », me répondit-il en les emballant dans du papier journal.
Nous nous serrâmes la main et je glissai la viande ainsi que mes conserves et fruits séchés dans un petit sac que j’avais pris avec moi, songeant déjà au festin que nous allions faire.
― Vous allez ramener tout cela à pieds ? » M’interrogea-t-il en écarquillant les yeux avec exagération.
Je soupirai.
― Oui, je n’ai pas le choix »
Il secoua la tête et me fit signe de le suivre. Nous traversâmes le couloir dans l’autre sens, passant devant la cuisine où sa famille en était à présent rendue au dessert et sortîmes de la maison. Je le suivis jusqu’à une sorte de hangar où étaient entreposées deux moto-neige.
― Prenez-en une pour aller jusqu’à chez vous cela sera moins fatiguant, vous la ramènerez ensuite. »
Je ne sus que dire, une fois encore pris au dépourvu.
― C’est très gentil à vous, mais je ne suis jamais monté sur un de ces engins, je ne sais même pas comment cela fonctionne. »
Il me sourit et leva les yeux au ciel.
― Vous n’avez jamais fait de moto ?
― Si, j’en possède une en France, mais c’est un autre type d’engin…
― Non, non c’est pareil, vous ne serez pas dépaysé. »
La discussion se poursuivit encore quelques minutes, ponctuée par mes refus et les insistances de mon nouvel ami. En réalité j’étais très enthousiaste à l’idée de monter dessus. J’avais vu bon nombre de suédois en utiliser au fur et à mesure que nous progressions dans le nord et cela ne semblait pas si difficile à prendre en main.
Je finis donc par accepter et si j’avais craint en premier lieu de ne pas lui rendre en parfait état, mon appréhension se dissipa aussi vite en l’examinant plus en détails: la moto-neige avait en effet dû voir passer quelques dizaines d’hiver et sa prime jeunesse était à présent bien loin derrière elle. Le carénage accusait bon nombre de chocs et éraflures tandis que la peinture, défraichie, ne trompait pas davantage sur l’ancienneté du véhicule. Je me rendis d’ailleurs bientôt compte à l’irrégularité de la teinte qu’elle devait déjà en être à sa deuxième ou troisième couche.
― Cette grosse chenille en a vu passer », me lança Sven en tapotant sur le réservoir d’un geste affectif. (Je ne suis pas sûr du mot « chenille » n’étant pas d’un excellent niveau d’anglais, mais c’est ce qu’il me sembla entendre, et à mon sens cela n’aurait pas été plus incohérent qu’un autre mot.)
Il enfourcha donc la « grosse chenille » et la réveilla à l’aide des clés qui étaient restés sur le contact.
― Ce n’était pas très prudent. » Dit-il en secouant la tête. Je dois dire à mon fils de les retirer quand il a fini de l’utiliser ».
― Vous avez un autre garçon ? » L’interrogeai-je machinalement.
(Dans mon souvenir, celui que j’avais aperçu dans la cuisine ne devait pas avoir plus de neuf ou dix ans).
― Non, un seul. » Dit-il d’un ton dégagé.
J’acquiesçai avant de revenir à la conversation:
― Vous avez peur des vols ? »
Il m’observa alors d’un air étrange, comme si je venais de prononcer un mot qu’il ne comprenait pas. Je repris:
― Tu as peur qu’elle disparaisse ? »
Pour une raison inconnue je venais subitement de me mettre à le tutoyer, (dans mon esprit en tout cas puisqu’avec la barrière de langue anglaise, il était difficile de retranscrire ce sentiment).
Après ce qui me parut être un moment de réflexion, Sven se passa la langue sur les lèvres et se mit à rire, un rire assez franc pour recouvrir sans mal le bruit du moteur.
― Non, je crains seulement qu’avec le froid la clef reste gelée à l’intérieur. »
J’acquiesçai sans mot dire.
Il m’expliqua comment manoeuvrer l’engin et après quelques essais dans la cour arrière de la maison j’étais prêt à partir. Nous fixâmes les courses sur le porte-bagages situé à l’arrière du véhicule, je le remerciai pour tout et pris congé après avoir promis de lui ramener la moto-neige dès que possible.
Hélène devait m’attendre à la cabane depuis un moment déjà et notre repas reposait après tout sur mes épaules. (Bien sûr j’étais aussi pressé de voir sa réaction lorsque je reviendrai sur une telle monture). Je sortis du village et croisai pour la première fois quelques habitants. Ils me saluèrent d’amples signes de la main que je leur rendis, était-il possible qu’ils m’aient pris pour Sven ? Avec mon épaisse veste et bonnet c’était tout à fait possible, mais quelque chose me disait qu’il devait s’agir davantage de simple civilité.
Je m’engageai donc sur la même longue route qu’à l’aller, pointant à l’horizon. Je conduisis la moto de la même manière que j’avais vu les suédois le faire: longeant le bord de la chaussée, là où la neige était la plus épaisse, bien que dans le cas présent cela ne faisait pas grande différence, en effet, avec le peu de voitures qui semblaient l’emprunter, la route se confondait en grande partie avec le bas-côté. Je choisis néanmoins de respecter la « tradition » autant que le code de la route et le voyage du retour fut bien sûr nettement plus rapide qu’à l’aller. En quelques minutes j’étais de retour à la cabane. Le soleil était maintenant haut dans le ciel et la neige irradiait ses rayons à travers le paysage, m’éblouissant malgré les lunettes de soleil. Je garai la moto-neige juste à côté de notre auto et mis quelques coups de gaz à blanc pour prévenir Hélène de mon retour, si tant est que le vacarme du moteur au milieu de cette immensité silencieuse ne s’en soit pas déjà chargé. J’attendis quelques instants, puis, comme cette dernière ne se montrait toujours pas, je m’entêtai en actionnant le klaxon à deux ou trois reprises. Je vis enfin la porte donnant sur la terrasse s’ouvrir et Hélène en sortir. Quelque chose dans l’expression de son visage m’interpella aussitôt sans que j’arrive précisément à déterminer quoi. Tout d’abord il y avait le fait qu’elle ne semblait pas surprise de me voir revenir sur mon engin. Non, en vérité elle n’y prêtait de toute évidence pas la moindre espèce d’attention. Son regard restait fixe, comme saisi d’une stupéfaction dont je ne pouvais déterminer les origines. Je tournai la clef dans le contact pour couper le moteur et les lieux recouvrèrent leur quiétude immobile.
« Pourquoi me regardes-tu avec ce drôle d’air ? Lançai-je sans me dépareiller de mon air malin. Surprise ? »
Je la vis acquiescer platement et jeter un regard à l’intérieur de la cabane.
« C’est bizarre. » Finit-elle par dire d’une voix éteinte.
Je gravis les marches menant à la terrasse.
― Quoi donc ? »
Elle s’écarta d’un pas sur le côté afin de me laisser libre l’accès à la cabane. Je jetai un oeil par la grande baie vitrée, toujours aussi interloqué de son attitude et franchis le pas de la porte en fronçant les sourcils. Je remarquai que nos valises avaient été défaites et que leur contenu – des vêtements en majorité – reposait sur le lit, plié avec soin. Hormis cela, tout semblait tel que je l’avais abandonné ce matin en partant. Je me tournai vers Hélène d’un air interrogatif. Elle m’avait suivi sans que je l’entende et se trouvai à présent dans mon dos comme pour se protéger de quelque chose.
― Qu’est-ce qu’il y a L’ ? » Lui demandai-je sans comprendre. « Tu as l’air toute drôle.
― Les vêtements ». Articula-t-elle d’une voix blanche.
― Eh bien quoi les vêtements ?
― Regarde, tes affaires, ce ne sont pas les tiennes. »
Je laissai passer quelques secondes pour digérer l’information et me retournai vers le lit où avait été entreposé mes jeans et chemises, ou en tout cas ce que croyais êtres les miens.
― Qu’est-ce que tu me racontes là ? » Je secouai la tête en m’approchant pour mieux les examiner.
― Tous tes jeans sont de la même marque et tu ne portes jamais de chemises à carreau ».
En effet je ne reconnaissais ni le jean, ni la chemise qui trônaient en haut de leurs piles respectives. Je me saisis du pantalon et examinai son étiquette.
― En tout cas la taille est presque la même que les miens, un tout petit peu plus large, je mettrai une ceinture pour compenser .
― Tu n’as quand même pas l’intention de porter cela ?
― Et pourquoi pas ? Je doute que son propriétaire vienne me le réclamer ici ?
― Mais ce n’est pas la question, je veux dire: cela ne t’intrigue pas plus que cela ?
― Et qu’est-ce qui devrait m’intriguer ? J’ai dû me tromper en récupérant un jean et une chemise au lavomatic de Kiru… »
Mais Hélène m’interrompit avant que j’ai pu finir ma phrase:
― Non tu ne comprends pas… » Elle marqua une pause. « Aucune des affaires présentes ici n’est à nous. »
Ce fut à mon tour de marquer un silence. Bien plus long que le sien.
― Tu veux dire… même tes vêtements ?
― Tout ce que nous avons emmené. »
Je me tournai vers les piles d’affaires et me mis en besogne de les examiner une par une.
Après quelques minutes je dus me rendre à l’évidence: aucune n’était à moi. Je relevai les yeux vers Hélène.
― Comment est-ce possible ? Ce sont bien nos valises pourtant, nous n’avons pas pu nous tromper en les chargeant dans la voiture au camping de Kiruna. »
Elle secoua la tête.
― Non, c’est incompréhensible. »
Nous gardâmes tous deux le silence un moment. Nos regards erraient dans le vide tandis que nous sondions les abymes de nos esprits à la recherche d’un germe d’explication rationnel. Hélène interrompit finalement le fil de nos pensées en me posant la question tant attendue à mon arrivée et je lui expliquai comment Sven m’avait prêté la moto-neige. Elle acquiesça pensivement et nous sortîmes par la porte donnant sur la terrasse pour aller chercher nos provisions. Sans trop savoir pourquoi j’éprouvai un profond soulagement à la vue de l’engin, toujours à sa place, et de mes courses, fixées à l’arrière. C’était sans doute idiot et un peu disproportionné, mais vue la tournure prise par les évènements depuis notre arrivée à la cabane, j’estimai que peu de choses auraient encore pu m’étonner. Nous remontâmes les paquets en un seul voyage et Hélène se mit en besogne de préparer le déjeuner pendant que je me remis à examiner nos vêtements et sacs de voyage. Ceux-ci étaient en bon état, bien pliés, et pour tout dire une douce odeur de lavande s’en dégageait comme s’ils venaient tout juste d’être lavés.
« La lessive du lavomatic de Kiruna n’avait pas le parfum de lavande » Dis-je tout haut sans m’en rendre compte.
Ce fut Hélène qui m’en fit prendre conscience.
« Qu’est-ce que tu as dit ? » Me lança-t-elle depuis l’autre bout de la pièce, affairée au dessus du lavabo.
Je m’approchai d’elle en continuant d’humer la chemise que j’avais dans la main.
― Ils n’ont pas été lavés avec la même lessive qu’à Kiruna en tous les cas. »
Elle secoua la tête.
― Tant bien même que nous ayons pris par erreur une affaire à quelqu’un d’autre… cela peut se comprendre… quelqu’un aurait pu avoir oublié une paire de chaussettes… Mais de là à tout échanger… ça n’est pas possible. Une fois lavés et séchés, j’ai pris la peine de plier ses vêtements avant de les ranger dans nos sacs. »
Et en effet elle les avait pliés. Je le sais parce que me souvenais avoir souri en voyant l’application qu’elle mettait à la tâche.
― Réfléchissons sous un autre angle: quand avons-nous quitté nos sacs des yeux et quelqu’un aurait pu y toucher ? »
Je balayai sa phrase d’un geste de la main.
― Mais enfin pourquoi quelqu’un aurait fait ça L’ ? Nous voler nos sacs ? Pourquoi pas. Mais en remplacer le contenu ? Ça n’a pas de sens.
― Je n’essaye même pas de comprendre les raisons, juste comment cela a pu se produire.
― Je ne vois pas quand… Après la lessive nous avons de suite chargé nos sacs dans la voiture et nous sommes partis pour la cabane. Nous sommes arrivés hier soir et les avons sorti dans la foulée… »
Je l’interrompis:
― Non je n’ai sorti que les petits avec nos affaires importantes. »
― Donc ils sont restés dans le coffre toute la nuit ? »
Je haussai les épaules.
― Oui, je suis retourné les chercher ce matin rappelle-toi. » Hélène s’apprêta à reprendre la parole mais je l’interrompis avant: «… Et oui, je suis sûr d’avoir fermé la voiture à clef… Cela m’a même fait sourire lorsque j’y suis retourné. »
― Et la voiture n’avait pas l’air d’avoir été…
― Fracturée ? Non. Pas le moins du monde.
Elle resta pensive un moment puis secoua la tête.
― Je trouve très étrange que l’on est ce problème là, en plus des pneus de la voiture. »
― L’ encore une fois : si quelqu’un voulait nous nuire il aurait simplement volé nos affaires, il ne les aurait pas échangées. » Je marquai une pause. « Surtout que… » Ma phrase resta en l’air. Elle m’incita à la finir d’un regard interrogateur. « Eh bien je n’ai pas encore fini de faire l’inventaire mais à première vue je dirai qu’elles ont beaucoup plus de valeurs que les nôtres… Ce ne sont que des fringues de grandes marques. »
Elle acquiesça pensivement:
― Je sais, j’avais déjà examiné les miennes… »
Je tournai un moment en rond au milieu de la pièce. Dans l’âtre se consumait doucement les restes d’un feu qu’elle avait dû allumer après mon départ. Je finis par m’asseoir dans un coin du canapé près de l’immense baie vitrée et laissai mon regard se perdre au dehors.
J’avais beau retourner la question dans mon esprit, je ne voyais aucune explication à cette échange. Même en admettant que cela fut là l’acte d’un tiers, j’entends : commis de son plein gré, cela n’avait à mes yeux aucun sens, sans parler du fait que la valeur des affaires substituées aux nôtres était bien supérieure.
De l’autre côté de la route, à l’orée du bois je vis passer un renne, bientôt suivi d’un autre. Le premier trottait à petite foulée et semblait jeune d’après sa fourrure claire et uniforme tandis que le second, au poil beaucoup plus sombre et irrégulier, avait toutes les peines à le suivre. Ils traversèrent le macadam pour disparaître entre les arbres, de l’autre côté de la route.
« Incompréhensible ». Me répétai-je intérieurement.
TROISIÈME PARTIE
Nous déjeunâmes dans l’heure qui suivit. La viande séchée que j’avais choisie chez Sven était aussi forte qu’appétissante. Sa chair, ferme et épaisse sous la dent exhalait à chaque bouchée un puissant arôme fumé, tout le contraire de ces viandes plates et sans saveurs que l’on trouve beaucoup dans les supermarchés. Nous fîmes également chauffer une boîte de haricots en guise d’accompagnement. Elle eut au moins le mérite de nous réchauffer, le soleil ayant beau demeurer à son zénith, le froid s’immisçait dans la cabane, à peine tenu en respect à deux ou trois mètres du poêle. Enfin, pour le dessert nous mangeâmes quelques fruits secs et cela fut notre pitance de la mi-journée.
Je repensai alors seulement à notre voiture de location. Les récentes péripéties m’avaient tellement perturbé que j’avais oublié de demander à Hélène ce que son appel avait donné. Elle me répondit qu’elle n’était parvenue à le joindre comme le réseau était quasi-inexistant. Je soupirai. Encore un soucis qu’il nous faudrait résoudre.
En début d’après-midi, pour nous changer les idées, nous décidâmes d’aller faire un tour jusqu’au lac qui s’étendait un peu plus bas, au sud de la route. Hélène tout comme moi, était encore perturbée par cette histoire de vêtements, mais je tâchai de n’en rien montrer et promis en tout cas d’en parler à Sven lorsque je lui ramènerai son engin. Je n’étais pas exactement sûr de ce qu’auraient bien pu être ses réponses à mes questions, (ni même quelles auraient pu être ces dernières) mais cela parut la satisfaire et nous nous mîmes en route, l’esprit plus ou moins serein.
Dehors, l’air était toujours aussi vif. Comme la neige n’était pas retombée depuis la veille au soir, le sillage tracé par nos allers retours entre la cabane et le reste de la cour était toujours praticable. Nous traversâmes la route et nous enfonçâmes dans la forêt, en direction du lac, prenant garde de ne pas trop dévier de notre trajectoire puisqu’il n’existait bien entendu aucun chemin. Le soleil était notre seule repère à travers la dense végétation transie sous l’épaisse couche neige. Nous nous enfoncions par endroits jusqu’à la ceinture. La progression n’était pas aisée et il nous fallut une bonne demi-heure pour couvrir le kilomètre qui devait nous séparer du lac. Lorsque nous quittâmes enfin les bois, ce fut pour déboucher sur une plaine d’herbe bleuie par l’atmosphère glacée. L’étendue d’eau se dressait un peu plus loin, encore gelée à certains endroits. Nous nous approchâmes. L’herbe craquait sous nos pieds comme des morceaux de verre. Au loin, nous apercevions l’imposante chaîne montagneuse du Särek qui se dressait à l’horizon comme l’épine dorsale d’une bête titanique ensevelie sous la terre.
Au fur et à mesure que nous approchions du lac, le sol devenait de plus en plus spongieux et humide. A chaque pas les touffes d’herbes jaunies s’enfonçaient dans le sol et rendaient de l’eau comme des éponges pressées.
Bientôt, nos chaussures s’enfoncèrent elles aussi jusqu’aux lacets et nous renonçâmes à aller plus loin. Il n’y avait aucun rocher, aucune souche d’arbre où s’asseoir donc nous fîmes demi-tour, perplexes comme peuvent l’être des marcheurs lorsqu’ils atteignent enfin un objectif, une destination ne présentant d’autre intérêt que celui d’y parvenir.
*
Nous fûmes de retour à la cabane aux environs de dix-sept heures.
« Je vais rendre la moto-neige à Sven ». Dis-je à Hélène.
J’avais en effet promis de lui ramener rapidement et je ne souhaitais pas lui faire une mauvaise impression dès la première opportunité.
La journée n’avait pas encore atteint son terme et il me restait une bonne heure avant que le soleil ne se couche (ce qui était ici bien sûr un abus de langage puisque celui-ci – comme je l’ai déjà longuement évoqué – ne disparaissait jamais vraiment). C’était en fait bien moins la luminosité que les températures qui me préoccupaient; je savais que passé une certaine heure, celles-ci chutaient dramatiquement et je voulais éviter d’être encore à l’extérieur lorsque sur le coup de dix-neuf heure, surgirait la vague du froid que nous avions déjà ressenti la veille.
Hélène acquiesça tout en s’inquiétant qu’il fut déjà si tard et je lui répondis plus ou moins par les réflexions que je venais de me faire. Je pensais avoir bien calculé mon coup: une dizaine de minutes pour ramener la moto-neige au village, une petite demi-heure pour revenir à pied, vingt minutes de marge en comptant ma future discussion avec Sven au sujet de nos affaires disparues. En définitive une heure, ce qui me ferait arriver à la cabane aux environs de dix-neuf heures, c’est à dire avant le début du grand froid. Je demandai à Hélène s’il ne manquait rien à mes courses de ce matin et elle me répliqua que c’était parfait, un baiser en prime. Cela me mit un peu de baume au coeur et je quittai presque avec bonne volonté la cabane pour me diriger vers la moto-neige. Je laissai tourner le moteur quelques minutes au ralenti, ne sachant pas trop s’il fallait beaucoup de temps pour le mettre à température, puis, le niveau d’huile m’indiquant soixante degrés et Sven ne m’ayant rien précisé à ce sujet, je jugeai qu’elle devait être prête à l’utilisation, comme n’importe quelle moto de grosse cylindrée, à condition de ne pas trop monter dans les tours. Je repris la route du hameau et le trajet fut encore plus rapide qu’à l’aller – l’habitude qui commençait sans doute à venir -. Il me fallut moins de dix minutes pour rallier la maison de Sven. Quelques badauds arpentaient l’unique artère, emmitouflés dans leurs épais manteaux. Ils me saluèrent de la main comme des connaissances de longues dates et je leur rendis. Sven sortit bientôt sur le palier, sans doute alerté par le vacarme du moteur. J’allai le couper lorsqu’il m’interrompit d’un geste de la main.
« Va la ranger derrière Syd » me dit-il, avec son accent à couper au couteau.
J’acquiesçai d’un signe de tête et dirigeai l’engin à l’arrière de la maison, dans le petit hangar où je l’avais prise le matin même.
― Tu l’as ramené vite, tu aurais pu la garder un peu plus. Vous vous êtes baladés toi et Hélène ? » Demanda-t-il en me rejoignant.
Je ne me souvenais pas lui avoir dit que ma copine s’appelait Hélène mais sur le coup je n’y fis pas plus attention que cela.
― Non, nous nous sommes baladés à pieds, on est allé près du lac, difficile de s’y rendre avec la moto. »
Il sourit en écarquillant les yeux.
― Oh le lac, oui oui, c’est impossible, il faut traverser le petit bois, il y a pas de place pour le snowcat. »
― Aucune chance de passer non.
― A cette période il n’y a pas grand chose à y faire, le lac gèle sur une épaisseur de quarante centimètres et on ne peut plus pêcher.
J’acquiesçai sans pouvoir m’empêcher de penser que l’on était déjà à la mi-mai et que la bonne « bonne saison » devait décidément être courte dans le coin.
― Si vous voulez faire du patinage par contre c’est sans risque. »
Cette dernière remarque attira mon attention comme j’avais bien repéré plusieurs paires de patins de différentes tailles entreposées dans une remise de la cabane.
― Vraiment ? » Fis-je intéressé. « Sans aucun risque ? Même à cette saison ?
― Absolument aucun. Les gosses y vont presque toute l’année sauf en été. »
Je souris en l’entendant parler d’été.
― Parce qu’il n’y a plus de glace ? » Répliquai-je avec humour.
Ce à quoi il répondit le plus sérieusement du monde:
― Si, mais elle n’est plus assez épaisse, il vaut mieux ne pas prendre le risque.
― Mon amie ne m’accompagnera jamais je pense.
― Elle ne sait pas patiner ?
― Elle aura trop peur que la glace cède sous ses pieds.
Il secoua énergiquement la tête.
― Aucun risque je te dis, à cette période même une voiture pourrait passer dessus sans problème ».
La conversation ne semblait pas sur le point d’en finir. Sven m’invita d’ailleurs bientôt à entrer chez lui prendre une « boisson chaude ».
Pour tout dire je m’attendais à ce que sa femme nous serve un chocolat chaud, mais ce fut mon hôte que je vis disparaître dans la cuisine d’un air satisfait. Je l’entendis ouvrir un placard et lorsqu’il revint quelques secondes plus tard, je compris que je m’étais fourvoyé. Il tenait dans les mains une belle bouteille décorée de dessins, ainsi que d’un cartouche bleu sur lequel était écrit « Mackmyra ». Il déboucha la bouteille d’une main, posant de l’autre deux verres sur la table basse du salon.
Je me tenais dans cette pièce pour la première fois et satisfait je pris cela comme un signe sans doute que nos rapports s’étaient resserrés. Il vida deux bonnes mesures de ce qui était – j’en étais à présent certain – du whisky.
« Une des fiertés nationales ! » Me lança Sven en levant son verre. Skäl ! »
« Skäl ! » Répétai-je en levant le verre à mon tour.
J’en pris une bonne gorgée et laissai la finesse du single-malt me monter au palais. Je perçus de jolies notes de vanilles et de cannelle, ainsi que, un instant ou deux plus tard, de menthe et de verveine.
― Il est bon. Dis-je. Merci. »
Et en effet il était délicieux. Je sirotai doucement mon verre en écoutant Sven me parler du coin et de ses habitants.
« Au départ il n’y avait que trois familles qui vivaient ici. Mes arrière grands-parents en faisaient partie. À l’époque il y avait des troupeaux de rennes partout où on allait. Ils n’étaient même pas domestiqués. Il fallait les voir arpenter les plaines par dizaines, c’était quelque chose ça. Maintenant ils ont tous des clochettes autour du cou comme des vaches à lait. »
J’interrompis Sven pour lui faire remarquer que tous ceux que nous avions vu depuis notre arrivée n’en portaient pas et semblaient parfaitement sauvages.
Il parut d’abord surpris et fit mine de garder le silence puis se ravisa après un bref moment d’hésitation.
― Vous avez dû mal regarder. Ici tous les rennes appartiennent à quelqu’un. Il n’y en a plus guère de sauvages sauf si vous montez très loin au nord. »
Ce fut à mon tour d’être étonné, d’abord parce que j’étais sûr d’avoir bien vu, ensuite parce que je trouvais difficile de concevoir que l’on puisse s’enfoncer davantage au nord. Un peu plus loin il n’y avait que l’immense toundra, somptueuse et mortelle, puis l’océan arctique, et enfin le pôle nord.
Sven pendant ce temps avait continué son histoire et je raccrochai les wagons comme je pus.
« …C’est au début du siècle, avec la mise en activité de la mine de Kiruna et tous les emplois que cela a crée que le coin a commencé à se peupler. »
Il s’interrompit et reporta son attention sur moi:
― Je ne t’ai jamais raconté cette histoire: celle du village ? »
Je secouai la tête, me demandant comment diable aurait-il pu. Ce n’était après tout que la seconde fois que nous nous rencontrions.
Il éluda la question d’un geste de la main et replongea dans ses pensées.
« …Des accidentés finissaient souvent ici. Des vieux qui partaient en retraite et ne souhaitaient pas finir leurs vieux jours au même endroit, avec les mêmes personnes qui les avaient vus trimer eau et sang toutes ces années, donc ils venaient ici… C’est à l’écart de la ville tout de même…
J’acquiesçai sans rien dire, par crainte de l’interrompre dans son élan volubile, et aussi soulagé de n’avoir pour une fois pas besoin de répondre à une série de questions sans fin.
«… Cette mine, ici c’est la vie et la mort. Elle a donné du travail à des milliers de familles de génération en génération. Certains y sont nés, d’autres y sont morts, parfois les deux. Ce qui est sûr c’est que les choses n’auraient jamais été ce qu’elles sont si elle n’avait pas existé. »
Je n’étais pas sûr de comprendre ce qu’il voulait dire par là mais choisis de me taire une fois encore. Une question cependant me brûlait les lèvres, et comme s’il avait lu dans mon esprit, mon hôte y répondit avant que j’y cède:
«… J’ai commencé à y travailler à l’âge de treize ans. À l’époque c’était l’âge où l’on pouvait effectuer des « travaux légers ». Au début je m’occupais surtout du ravitaillement, d’apporter les déjeuners, faire le plein d’essence, actionner l’ascenseur quand il fallait etc… Ça n’était pas le rêve, le travail était long et pénible, mais à travers des yeux de gamin, partir au boulot le matin avec les hommes, cela semblit une sacrée reconnaissance. Bien sûr c’est de l’exploitation, et les patrons de la mine s’en foutent plein les fouilles tandis qu’on en voit pas une miette… Mais je vous l’ai dit: est-ce qu’on pense à tous ces trucs quand on est môme ? Certainement pas. Trop fier de la trimballer la gamelle de purée-saucisses, de le presser le bouton de l’ascenseur, de servir le café dans le thermos… »
A ces mots son regard se perdit dans le vide, le voile du souvenir passa à la surface de ses iris, comme un vieux pavillon trop souvent hissé et ne flottant plus au vent que par lambeaux.
«… Puis j’ai grandi, j’ai miné moi aussi bien sûr. Tôt ou tard on y vient tous. Il y a eu des accidents. J’ai perdu quelques amis. Puis les enfants sont nés, un par un. Voyez, quand cela commence à pousser ses bêtes là, on ne sait jamais jusqu’où cela va aller. Bref je ne sais plus si c’était une question de timing, la mort de certains copains, la naissance de mon premier premier, mais toujours est-il que je suis parti. Ça n’a pas été facile, je n’ai jamais eu autant l’impression quitter le navire en pleine tempête, de déserter en plein combat. J’ai fait l’armée mais je ne me suis jamais battu. Ceci dit j’imagine que cela devait se rapprocher de cette impression, vous voyez ce que je veux dire… »
Je ne voyais pas mais je ne l’interrompis point.
«… Il y avait les regards, la honte de partir… « Ils » me la faisaient ressentir. Mais je crois que l’amour des mioches fait tout disparaître et l’on n’y pense plus. En tout cas cela a marché pour moi. On s’est installé ici. Et même si encore aujourd’hui, parfois lorsque je traîne mes guêtres en ville, à Kiruna, il m’arrive de recroiser un de ces regards, d’un vieux copain, ou de leurs connaissances – les histoires traînent si vite de bouche en bouche – eh bien je n’ai jamais regretté une seconde de la vie mon choix. J’ai un commerce qui marche bien, une maison chaude et douillette, des enfants qui vont à l’école presque tous les jours. Et tout va presque pour le mieux n’est-ce pas ? »
En prononçant ses derniers mots, son regard, dur depuis quelques minutes, s’était soudain réchauffé. Il se posa sur moi. J’acquiesçai en lui tapotant le bout du genou. Geste dont je me surpris moi même, d’ordinaire si peu tactile. Mais les choses devaient être sans doute ainsi: quand un homme s’ouvre, on ne devrait pas se sentir obligé de se cantonner à son rôle de convive poli et inhibé.
Dans un coin de la pièce, je vis que la femme écoutait d’une oreille distraite tout en feuilletant une revue dont je ne parvins à identifier le sujet. Sven m’avait dit qu’elle ne comprenait pas l’anglais donc je supposai que le son de sa voix, profonde mais harmonieuse, avait suffi à capturer une partie de son attention. Les enfants avaient été couchés depuis un moment, en fait depuis que mon hôte avait débuté son histoire. Ce qui ne voulait pas dire pour autant qu’ils étaient endormis. Cela avait été en tout cas ma pensée lorsque la mère, à plusieurs reprises s’était levée au son d’un reniflement de l’autre côté de la porte. Moi aussi je m’étais laissé bercer par l’histoire. Au dehors, je remarquai que la neige s’était remise à tomber. Le soleil malgré tout devait être encore haut perché dans le ciel comme la visibilité restait bonne. Je me retournai pour jeter un oeil à la pendule accrochée au mur et ne pus réprimer un sursaut.
« Mais il est déjà dix-neuf heure passé ! »
Sven qui me faisait face n’eut qu’à lever un oeil vers la pendule. Il se redressa sur son fauteuil et haussa les sourcils.
― Je parle, je parle, et le temps passe. »
Je reposai mon verre sur la table basse qui nous séparai, celui-ci m’imita, et sa femme disparut bientôt dans la cuisine, les emportant tous les deux. Le robinet s’ouvrit, bientôt suivi d’un bruit de vaisselle.
― Je vois que tu es bien couvert. Bon réflexe. À partir de cette heure il fait un froid mortel.
― Oui, je vais vous laisser, mon amie va s’inquiéter.
Il acquiesça platement. Sans que je parvienne à la déchiffrer, son visage arborait une expression singulière, mélange de gêne et culpabilité, comme un enfant pris à faire une bêtise. Je suivis son regard qui se perdait par la fenêtre située à ma gauche, celle-ci offrait une vue dégagée du centre du hameau. Je remarquai alors seulement qu’il n’y avait déjà plus âme qui vive dans la rue. Pire: les lumières à l’intérieur des maisons s’étaient tues.
― Il va commencer à faire sombre », murmura Sven en quittant la pièce. « Je vais te chercher une lampe. »
Il me vint alors à l’esprit la pensée désagréable que j’avais pu abuser de l’hospitalité de mes hôtes et que ceux-ci avaient peut-être pour habitude de se coucher tôt, ou du moins de s’adonner à d’autres occupations que recevoir, passé dix-neuf heure. Je me sentis d’abord quelque peu embarrassé, puis chassai vite cette idée de ma tête. La promptitude avec laquelle sa femme avait débarrassé la table pouvait être surprenante en effet mais qui sait peut-être n’était-ce qu’un usage, une habitude ? Et c’était après tout Sven qui s’était lancé dans son long monologue. Je n’avais pour ma part rien fait pour l’interrompre, ni le relancer, je m’étais contenté de garder le silence donc j’estimais n’avoir pas grand chose à me reprocher. Tout cela ne devait être encore que pur fantasme de ma part comme sa femme revint au même moment dans le salon et que je ne pus lire sur son visage aucun signe d’agacement, ni d’impatience. Bien au contraire elle retourna s’asseoir à la place qu’elle avait occupé jusqu’alors et se replongea dans son magasine. J’entendis le pas lourd de Sven se rapprocher et il reparut dans le salon, une énorme lampe torche de la taille d’un projecteur de chantier dans la main. Pour tout dire je n’étais pas bien sûr de l’utilité d’une lampe, en particulier de cette taille, mais j’appréciai le geste de mon hôte et le remerciai avec chaleur en me saisissant du lourd appareil.
Sa femme releva alors le nez de son magazine, m’observa un instant puis se tourna vers son mari et commença à lui parler en suédois. Je relevai son rythme soutenu et la pointe d’irritation qui y perçait. Sven ne disait mot mais semblait on ne peut plus embarrassé. Leur « échange » si on peut l’appeler ainsi ne dura qu’un court instant puis il se tourna vers moi, le teint vaguement empourpré et comme les mots ne quittaient toujours pas ses lèvres je haussai les sourcils pour l’encourager.
« Ma femme… » bafouilla-t-il.
Il y aurait sans doute eu quelque chose de comique à voir un tel gaillard ainsi embarrassé, la mine piteuse, si je n’avais précisément été au centre de cette même confusion.
«… Elle n’est pas d’accord pour que je te laisse partir à cette heure. »
Frappé de surprise, je répondis machinalement avant d’avoir repris mes esprits:
― Elle ne veut pas que je m’en aille ?
― Elle dit que tu dois rester à la maison, passer la nuit ici. Dehors il fait trop froid à présent. »
Je fis mine de jeter un oeil négligent par la fenêtre.
― Oh, je suis sûr que ça ne doit pas être si terrible que ça.
Sven s’avança alors à ma hauteur.
― Oui je sais. C’est que les gens qui ne sont pas d’ici disent toujours. »
Je tendis une oreille attentive et sentis sa main se poser sur mon épaule.
«… C’est la lumière du jour qui provoque cela. Mais à cette heure la température est glaciale. »
De l’autre côté de la fenêtre, à travers le verre voilé de la buée de nos souffles, j’aperçus sur la terrasse un thermomètre qui pendouillait à une poutre apparente de la toiture. Sven suivit mon regard puis secoua la tête.
« Je ne parle pas de température ambiante mais bien de ressenti. »
Au même moment, comme pour étayer ses propos, une longue bourrasque balaya toute la rue, insufflant au thermomètre qui pendouillait sous nos yeux une étrange chorégraphie endiablée.
« Le soleil n’est pas notre allié dans cette région, il est faux, comme corrompu, il perturbe l’équilibre des choses. »
Je me tournai vers Sven, comme pour être sûr qu’il venait bien de prononcer ces mots étranges. Mais ses lèvres étaient closes dont je ne sus dire s’ils étaient bien lui, ou simplement les fruits de mon imagination qui m’avait joué un tour en arpentant l’abîme de mon subconscient. Car j’étais assez d’accord avec l’idée. Le soleil jouait ici un drôle de double jeu.
« Ma femme a raison: si tu pars maintenant, avec la longue marche pour revenir à la cabane, c’est sûr que le vent du soir va te faire crever de froid. »
À cause de la barrière de langue, je ne sus dire s’il parlait au sens propre ou figuré. Toujours est-il que vue l’insistance de sa femme à me garder ici au chaud, et le peu de résistance qu’il lui avait offert, je devinai que cela devait être au minimum, un avertissement sérieux. Il n’empêche que je me trouvai bien idiot. Hélène devait commencer à s’inquiéter comme je lui avais promis être de retour avant dix-neuf heure et que cette limite était déjà passée depuis un moment. Il fallait que je la contacte mais le réseau serait-il assez puissant ? Rien n’était moins sûr d’après l’expérience de la matinée et notre incapacité à joindre le loueur de la voiture. Je pestai intérieurement face à ce paradoxe des technologies modernes et l’impossibilité d’entrer en contact tandis que nous ne nous trouvions qu’à une poignée de kilomètres l’un de l’autre. J’espérais surtout qu’Hélène n’aurait pas l’idée de sortir m’attendre par ce froid ou pire: marcher jusqu’au hameau pour me rejoindre. Je commençai à ressentir un vrai malaise et Sven dut le remarquer comme il s’approcha de moi.
« On va te préparer la chambre d’ami, ce n’est pas négociable, il faut que tu restes ici ce soir. »
Je m’abstiens de lui dire que ma décision à ce sujet était déjà prise.
Après tout je n’étais pas borné au point de ne pas faire confiance à un habitant du coin – qui plus est un robuste gaillard – lorsque celui-ci me mettait en garde contre les dangers, semble-t-il très réels, à sortir dehors à cette heure. J’en avais déjà eu un aperçu à notre arrivée, la veille.
Non, ma seule préoccupation était désormais de contacter Hélène, ce dont je fis part à mon hôte en sortant mon téléphone de ma poche. Je sélectionnai son contact, « Love », et le portai à mon oreille. Un instant plus tard cette tonalité typique de l’absence de réseau se fit entendre et je poussai un soupir.
― Quelle surprise… »
Sven secoua la tête.
― Les mobiles passent très mal ici.
― Tu veux dire qu’ils passent tout de même parfois ? »
Il haussa les épaules.
― Je reçois un peu de signal lorsque je roule sur la route, plus on se rapproche de Kiruna et plus il y en a. Ici au village ça fait toujours drôle de recevoir d’un seul coup une notification facebook ou autre… Mais ça arrive.
― Ça arrive… » Répétai-je pensivement, puis à l’intérieur de moi: il va me falloir un peu mieux que ça pour le coup. »
Sven parut alors se perdre dans ses pensées et lorsqu’enfin il remarqua que j’étais en train de l’observer, il parut accuser quelque gêne. Mon regard se fit plus insistant et il reprit la parole d’une voix trouble et incertaine:
― Bon mais autrement il existe peut-être un moyen simple de contacter la cabane… »
Je me tournai vers lui et fronçai exagérément les sourcils afin de lui signifier qu’il venait d’obtenir toute mon attention.
― Il y a longtemps le village avait mis en place un système permettant de communiquer avec des endroits plus ou moins éloignés. Un système sonore.
Je n’étais pas certain d’avoir bien compris tout ce qu’il venait de me dire, aussi je haussai les épaules d’un air neutre:
― Un système sonore ? Qu’est-ce que tu veux dire? »
Il s’éclaircit la gorge, toujours aussi confus.
― Eh bien je ne connais que les rudiments. Comme tu t’en doutes, cela existait bien avant que je naisse, je ne suis même pas sûr qu’il y ait encore un de ces concepteurs en vie dans le village. Cela avait été mis en place bien avant l’arrivée des portables, en fait même avant même l’arrivée du téléphone tout court. Tu ne le sais sans doute pas mais il y a une petite mine pas très loin d’ici.
Je pris un air intéressé:
― Vraiment ?
― Oh c’est une poussière à côté de celle de Kiruna, d’ailleurs elle n’est même plus en activité aujourd’hui, mais ce système permettait au village de communiquer facilement avec eux. »
― De communiquer à propos de quoi ? » Demandai-je de plus en plus intrigué.
― Oh toutes sortes de choses, les problèmes courants: en cas de blessé à la mine par exemple. Il y avait un code que tout le monde au village connaissait, et quand les gens d’ici l’entendaient il fallait envoyer le docteur. À l’inverse la mine qui se trouve plus loin dans l’ouest, devait prévenir le village en cas de tempête de neige en approche, ce genre de choses. C’est une procédure qu’ils ont mis en place à divers endroits isolés dans les environs du village afin de palier à ce genre d’ennuis. Les tempêtes peuvent être très soudaines et violentes par ici, en particulier celles arrivant par l’ouest…
Incapable de faire preuve de davantage de patience je l’interrompis:
― Mais ce fameux système, de quoi s’agit-il ?
― Eh bien pour des raisons évidentes liées à notre environnement: le soleil et les montagnes il était difficile de mettre en place un système lumineux, visible par tous à tout moment, donc les anciens ont opté pour le son, ils ont choisi un instrument avec une portée importante et aussi susceptible de pouvoir être utilisé par tout le monde: il s’est avéré que le cor était leur meilleur candidat.
Je haussai les sourcils.
… Alors je ne sais pas précisément quel type de cor, mais je sais que cela marche bien. Chaque famille en a un, ainsi que chaque site éloigné. Ils ont ensuite écrit un code ou telle suite de notes correspond à tel message, « nous allons bien », « blessé » , « tempête » ce genre de messages.
― Voilà qui explique que ce matin lorsque nous faisions un peu de rangement j’en ai trouvé un, impeccablement rangé dans une boîte, avec tout tas de partitions. Je n’ai pas pris le temps de les examiner mais j’imagine que c’était le code inventé par les anciens du village.
― Très certainement ». Approuva Sven. Nous ne l’utilisons plus depuis bien longtemps mais je suppose que dans le cas présent cela peut valoir le coup d’essayer. Est-ce que Hélène était là lorsque tu as examiné le cor ?
― Oui, nous nous sommes demandés à quoi cela pouvait bien servir… Et c’est une chance: elle joue du piano. »
Mon hôte se leva de son siège et parla quelques instants à sa femme. Je la vis s’éclipser en vitesse.
― Il reste à espérer qu’elle fera le lien entre la mélodie et ce que vous avez vu ce matin. »
J’acquiesçai, songeant que c’était une sacrée conjecture.
« … C’est une fille intelligente, cela devrait marcher. »
Je ne prêtai guère d’attention à cette dernière phrase, – au delà du fait qu’il n’avait bien sûr pas tort -, mais j’avais l’esprit trop occupé par la situation.
En ce qui me concerne je ne savais pas lire la musique donc le problème aurait été réglé, mais Hélène, elle, en était capable. C’était sans compter sur le fait qu’il fallait encore faire le lien entre le code et la mélodie. Tout ceci me semblait affreusement tiré par les cheveux mais s’il y avait une chance que cela marche alors cela valait sans doute le coup d’essayer.
« Au pire, cela fera des histoires à raconter. » Songeai-je.
Je dois avouer, avec le recul, avoir sans doute pris tout cela un peu trop à la légère. En fait j’étais assez confiant par rapport à Hélène; me doutant bien qu’elle trouverait une explication logique à mon absence et qu’elle n’entreprendrait rien de déraisonnable. Mon sommeil aurait été néanmoins plus tranquille en la sachant prévenue et hors de toute inquiétude.
À l’autre bout de la maison j’entendis ce qui semblait être une échelle en train d’être dépliée, puis le bruit d’une trappe que l’on ouvre et enfin des pas au dessus de ma tête,dans ce qui devait être le grenier. J’échangeai un regard avec Sven et celui-ci haussa les épaules.
« Je t’avais dit: on ne s’en sert plus depuis belle lurette. »
*
Quelques instants plus tard, sa femme – dont il commençait à devenir urgent que je m’enquière du nom – revint, soulevant une lourde caisse en bois similaire à celle que nous avions trouvé avec Hélène dans la cabane. Elle s’empressa de la déposer sur le plancher et Sven de l’ouvrir. Le contenu ne me surprit pas. Un cor et le même ensemble de feuillets de papier musique griffonné d’une écriture manuscrite. Mon hôte se pencha sur la caisse et commença à les examiner rapidement l’une après l’autre jusqu’à ce qu’il se redresse d’un air triomphant, une vieille feuille jaunie à la main.
― Trouvée » Me dit-il. Viens, on va aller se mettre au fond du jardin. »
Je n’étais pas plus enchantée que ça à l’idée de sortir mais d’un autre côté je pouvais comprendre qu’il ne souhaite pas utiliser l’instrument à l’intérieur de sa maison, ce qui n’aurait pas manqué, d’une part de diminuer sa portée, de l’autre de réveiller ses enfants.
Nous enfilâmes tout deux nos épais manteaux et franchîmes le pas de la porte. Je me bénis aussitôt d’avoir eu la présence d’esprit de ne pas refuser l’offre de mon hôte de passer la nuit sous son toit. Les bourrasques glacées déferlaient en continu le long de l’unique artère du hameau, et chacune d’entre elles était un coup direct à encaisser. Je sentais mes résistances s’éroder un peu plus au fur et à mesure que nous progressions vers le fond du jardin, orienté dans la direction de la cabane autant que mon sens de l’orientation pouvait en juger. La lumière était encore suffisante pour que l’on puisse s’y diriger sans lumière mais Sven avait tout de même emporté une petite lampe de poche et son faisceau se détachait à grand peine de la lumière du jour imprimée sur le sol neigeux. Nous nous abritâmes sous une sorte de petit hangar de taule aux murs ouverts et mon hôte se saisit du cor tout en examinant plus en détail l’une des feuilles qu’il avait apportées.
« Si je me rappelle bien… » dit-il en plaçant l’embouchure de l’instrument à ses lèvres.
― Comment joues-tu des notes là dessus ? Je ne vois aucun trou. »
― C’est justement ce qui est pratique: il n’y a qu’une seule note, le mi-bémol, (Il marqua une brève hésitation), autant que je me souvienne… »
― Donc tout ce qui compte c’est le nombre de fois que tu la joues et aussi la durée ? » Dis-je en examinant pour la première fois l’une des partitions en détail. Elle ressemblait effectivement plus à du morse qu’à une oeuvre de Mozart.
― C’est ça. »
Et sans prévenir, mon hôte souffla vigoureusement dans l’instrument. Un son ample et presque assourdissant s’en échappa aussitôt, me forçant à me boucher les oreilles et reculer comme je m’étais placé juste à côté du pavillon. Une série de quatre notes s’élevèrent dans le hameau et s’étendirent au paysage, figé sous l’épaisse couche de neige mais vibrant quelques secondes sous l’impulsion formidable du cor qui grondait entre les mains de Sven. Il rejoua ainsi la série de notes à cinq reprises séparées d’une trentaine de seconde, si bien que le vacarme dura cinq bonnes minutes.
Sans trop savoir pourquoi je ne m’étais pas soucié un seul instant de la gêne que l’utilisation de l’instrument n’allait pas manquer de provoquer et c’était maintenant que je me trouvais devant le fait accompli qu’une certain embarras s’empara de moi. J’avais bien pensé aux enfants de Sven qui risquaient d’être réveillés si nous jouions trop près de la maison mais je me rendais à présent compte qu’il était en fait décemment impossible d’envisager que le hameau entier ne soit pas sur le pied de guerre après un tel raffut. Mon hôte se tourna dans ma direction, la mine joyeuse.
« Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas entendu ce son ici… Maintenant il ne nous reste plus qu’à attendre, voir si votre amie répond. »
Nous attendîmes encore quelques minutes, mais sans grande surprise, aucune réponse ne vint. Trop occupé à danser sur un pied en tapant sur mes jambes pour me réchauffer, je ne vis pas Sven porter une nouvelle fois le cor à ses lèvres, et eus encore moins l’opportunité de l’interrompre. Le vacarme du cor résonna donc une nouvelle fois. J’avais déjà remarqué que quelques lumières s’étaient rallumées dans les maisons avoisinantes, mais ce n’est qu’après avoir vu apparaître une grande silhouette à l’autre bout du jardin, près du portail d’entrée de la maison que je sus que les ennuis arrivaient. Elle se rapprocha de nous d’un pas rapide mais Sven qui l’avait pourtant remarqué du coin de l’oeil ne cessa de souffler dans le cor. Je découvris bientôt le visage d’un homme âgé, approchant sans doute les soixante-dix ans, mais avec le corps toujours robuste d’une personne s’étant adonnée toute sa vie aux travaux manuels. À ma grande surprise je ne lus aucune hostilité dans son regard lorsqu’il nous rejoignit mais plutôt une vive curiosité avec également une pointe de douce mélancolie.
Il me salua d’un signe de la tête et entreprit une conversation en Suédois avec Sven. Je remarquai cependant que mon hôte et le nouveau venu désignait fréquemment le cor par des signes de la main, ce qui en soit n’avait rien d’inattendu comme j’imaginais mal que leur conversation puisse porter sur autre chose. Après quelques minutes le vieil homme se saisit de l’instrument et sans hésitation souffla à son tour vigoureusement dans l’embouchure. La mélodie – si l’on peut l’appeler ainsi – n’était pas très différente de celle jouée par Sven mais j’y relevai tout de même un caractère plus affirmé, ce qui pouvait je suppose, s’interpréter comme de l’assurance. Il rejoua ainsi la « mélodie » à trois reprises et, à ma grande surprise, au milieu de la quatrième, le son d’un autre cor, celui-ci lointain se fit entendre. Le vieil homme s’interrompit et nous tendîmes l’oreille. La suite de notes qui nous parvenait était légèrement différente de celle que nous jouions depuis tout à l’heure. Elle était aussi nettement plus faible et je suspectais que cela ne fut pas seulement à cause de la distance. Je remarquai aussi une sorte d’hésitation entre chacune, déjà frêles et vacillantes.
Au bout d’une minute ou deux et après s’être fait entendre à trois reprises, le cor se tut. Le vieil homme et Sven échangèrent quelques mots en suédois et ce dernier m’expliqua avec une joie palpable et presque enfantine que la mélodie que nous venions d’entendre signifiait grosso-modo: « Bien reçu. Ici tout va bien. » Je poussai un soupir de soulagement et mon hôte m’adressa une petite tape sur l’épaule.
― Maintenant tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Heureusement qu’Hélène a l’esprit vif ! »
Je pris un bref instant pour méditer cette dernière phrase. Effectivement elle l’avait eu – non pas que j’en ai douté de quelque façon que ce soit – mais ce qui venait de se passer tenait encore pour moi d’un petit miracle. Je me contentai finalement d’acquiescer avec un petit sourire et nous quittâmes le vieil homme sur le seuil de la maison après maints saluts et signes de la main.
Alentour, les maisons étaient retournées à leur torpeur comme les rideaux recouvraient à nouveau les fenêtres pour empêcher la lumière de rentrer.
La chaleur du foyer vint caresser ma peau lorsque je pénétrai à l’intérieur.
Il était tard à présent. Sven me conduisit à ma chambre après en avoir rajouté sur la « vivacité d’esprit d’Hélène ». J’eus l’agréable surprise de constater que sa femme avait dû s’affairer à sa préparation lorsque nous étions dehors comme le lit était déjà fait et qu’à en juger l’odeur des draps, ceux-ci ne devaient être étendus sur le matelas depuis bien longtemps. Il n’y avait du reste aucun bruit dans la maison. Était-il envisageable que les enfants n’aient été réveillés par le son du cor ? Je jugeais cela impossible mais d’un autre côté il ne s’était pas écoulé beaucoup de temps entre les dernières notes de l’instrument, la réponse d’Hélène, et notre retour. Il me semblait étonnant que ceux-ci aient pu se rendormir si vite… Mais c’était après tout de jeunes enfants et il ne fallait pas sous-estimer leur appétit de sommeil. Pour ma part les paupières m’en tombaient et je me dépêchai donc de me dévêtir. J’étais impressionné par la faculté de ces maisons en bois à conserver la chaleur puisque même en sous vêtement, je ne ressentis aucun frisson. C’était sans doute pour cette raison qu’il n’y avait qu’une simple couverture en laine posée sur le lit. Détail qui m’avait d’abord frappé, mais qui trouvait à présent une explication. J’entendis frapper à la porte et la voix de Sven se fit entendre:
― Syd, si tu as froid cette nuit, il doit y avoir des couvertures dans l’armoire à côté du lit… »
Il y avait en fait une armoire de chaque côté du lit, mais comme je n’anticipai pas le besoin d’une couverture supplémentaire durant la nuit, je ne pris la peine de les ouvrir l’une et l’autre pour vérifier.
― Merci Sven, bonne nuit », lui lançai-je à travers la porte.
― Bonne nuit. »
J’entendis son pas lourd s’éloigner dans le couloir et descendre l’escalier qui m’avait conduit à mes quartiers un peu plus tôt. Je trouvai quelque chose d’étonnant au fait que sa propre chambre, ainsi que celle des enfants, soit au rez-de-chaussée tandis que la mienne – celle des invités donc – se trouva à l’étage.
Je songeai ensuite que cela devait être le genre de réflexion émanant d’un esprit fatigué par une longue et dure journée donc je ne la prolongeai pas et me glissai sans plus attendre sous mes draps. Bonté divine, on avait dû y glisser une bouilloire. Je ne voyais pas comment les choses auraient pu en être autrement puisque les draps étaient tièdes. Je me délectai de cette attention charmante et laissai encore mon esprit divaguer au gré de mes pensées, relevant que j’avais oublié de parler à Sven de notre soucis de pneus crevés et me promettant d’évoquer le sujet en première instance demain matin. Plus bas, en fait juste sous le plancher, j’entendis le craquement d’un lit dans lequel vient s’allonger une lourde masse et je devinai que la chambre de mes hôtes devaient se trouver juste en dessous de la mienne. Ce détail, de façon inexplicable, me perturba quelque peu et je tâchai de ne pas trop remuer afin de ne pas faire craquer le sommier. Je mis cette drôle d’idée sur le compte de l’espèce de culpabilité que je continuai d’éprouver à m’être fait piéger ainsi par l’heure et n’avoir su rentrer plus tôt, pour m’en tenir à mon programme d’origine. D’un autre côté, je trouvais au fond de moi curieux que Sven, un habitant du coin, n’ait eu la présence d’esprit de s’en rendre compte pour moi. Son récit sans doute, l’avait transporté ailleurs, et diminué son attention. Mais pour une région où sortir passé une certaine heure semblait si dangereux, voir fatal dans certains cas, je ne m’expliquai toujours pas qu’il eût pu laisser ainsi le temps filer…
Dehors, les puissantes bourrasques semblaient s’intensifier tandis que j’observais toujours de minces filets de lumière se glisser par les interstices du rideau recouvrant l’unique fenêtre de ma chambre.
Ce fut l’esprit tourmenté par ces réflexions que le sommeil me gagna – vraisemblablement d’un coup – comme je me trouvais encore au beau milieu d’un débat intérieur sur ma culpabilité dans cette affaire et que je ne le vis pas venir.
*
Le lendemain, je me réveillais sur le tard. C’est du moins ce que je crus dans un premier temps, à la vue des faisceaux de lumière qui inondaient la pièce, puis je me souvins alors où je me trouvais et à quel point cela ne signifiait rien. J’attrapai ma montre, un magnifique modèle automatique à bracelet noir en cuir d’alligator et verre saphir, que je m’étais offert il y a quelques mois, lorsque les affaires avaient commencé à bien marcher, et y jetai un rapide coup d’oeil. Il n’était que sept heures. Ce qui voulait dire que j’avais dormi moins de six heures depuis la veille. Pourtant je me sentais parfaitement éveillé et en forme. Je décidai de ne pas m’attarder au lit et commençai donc à me vêtir. Une douce odeur de café et de pain grillé me parvint. Le reste de la maison était déjà debout comme j’entendais les gamins courir sur le plancher, détail qui en temps normal ne m’aurait pas mis de bonne humeur, mais qui dans le cas présent m’enchanta de façon inexplicable. Je descendis les rejoindre. Sven était déjà vêtu des pieds à la tête, sa grosse doudoune sur le dos, et semblait sur le point de sortir.
Nous nous saluâmes chaleureusement et lorsque je lui demandai avec humour s’il allait chercher le courrier, celui-ci me répondit avec sérieux – sans doute n’avait-il pas saisi l’ironie de ma question – qu’il partait en fait travailler. Où ? Je ne parvins à le saisir comme c’était un mot suédois qu’il prononça de façon naturelle et que je n’étais du reste pas du tout familier de la géographie des environs.
Je repensais alors à ma réflexion de la veille de lui parler de mon problème de pneus.
« Au fait, dis-je en prenant un ton dégagé. Nous avons eu un petit problème moi et mon ami en arrivant à la cabane.
Il me jeta un regard interrogateur.
«… Les roues de notre auto étaient crevées lorsque nous sommes retournés chercher nos affaires le lendemain. Est-ce que c’est quelque chose de courant dans la région ? »
Il m’observa d’abord sans rien dire comme s’il n’était pas sûr d’avoir bien compris le sens de ma question puis afficha une petite moue.
― Tu n’as vraiment pas de chance dis donc, ce n’est pas la première fois que cela t’arrive pas vrai ? »
Cette réflexion me surprit. Je fouillai rapidement ma mémoire. Il m’était certes déjà arrivé une ou deux fois ce genre de mésaventure, mais c’était en France, il y a longtemps. De quoi pouvait-il bien parler ? Pour une raison que je ne parvins à m’expliquer cette dernière réflexion me perturba. Nous ne nous connaissions après tout que depuis un jour ou deux et pourtant, l’attitude de mon hôte me semblait déjà plus familière que la veille, comme si nous nous connaissions depuis plus longtemps que mon esprit ne parvenait à l’imprimer. Je me sentais confus, comme le lecteur qui sans s’en rendre compte, vient de sauter plusieurs pages de son livre et ne retrouve pas les personnages exactement à la place où il les avait laissés.
Je n’eus de toute façon guère le temps d’approfondir cette réflexion comme celui-ci reprit bientôt:
― « Les » pneus, tu veux dire qu’il y en avait plusieurs de touchés par la crevaison ? »
― En fait tous.
― Tous ? » Répéta-t-il sous l’effet d’une surprise non dissimulée.
J’acquiesçai tandis qu’il posa au sol le sac qu’il portait jusqu’alors sur le dos. Je m’en voulais quelque peu de l’attraper ainsi sur le départ et de le retarder mais je n’étais pas sûr de la prochaine fois où nous nous reverrions et c’était pour le moment la seule personne du coin avec laquelle j’avais établi un contact.
― Les crevaisons sont des problèmes relativement fréquents dans le coin… encore que nous roulons tous en 4*4 avec des pneus adaptés au terrain… Mais les quatre d’un coup c’est très étonnant. »
― Oui, d’autant plus qu’ils n’étaient pas encore à plat lorsque nous sommes arrivés à la cabane. C’est certes mon amie qui conduisait mais la route a beau être bien droite, je pense qu’elle s’en serait rendu compte si c’était arrivé pendant que nous roulions n’est-ce pas ? »
― Il faut un sacré choc, ou quelque chose de drôlement pointu pour percer un pneu, même d’une voiture standard. Vous n’avez vraiment pas de chance tous les deux…»
(Encore cette réflexion étrange..)
Je haussai les épaules et vit Sven esquisser un sourire gêné
« Tu m’excuseras d’en rajouter mais je me méfierai à ta place, tu sais ce que l’on dit: jamais deux sans trois… »
J’eus cette fois toutes les difficultés du monde à réprimer l’envie d’éclaircir ses propos obscurs mais remarquant aussi tous les efforts de mon hôte pour dissimuler la hâte dans laquelle il se trouvait, j’aiguillai la conversation sur sa fin:
― Tu as sans doute raison… On va se débrouiller avec le loueur… Et merci de ton conseil, dis-je en lui adressant un sourire complice, j’ouvrirai l’oeil la prochaine fois. »
Il approuva d’un signe de la tête en remettant son sac sur le dos.
« … Au besoin je pourrai toujours vous ramener un jeu de pneus en allant à Kiruna. J’ai prévu d’y aller dans quelques jours pour ravitailler le magasin de toute façon. »
Je le remerciai une fois encore de son aide et il me laissa entre les mains de sa femme qui comme je l’avais suspecté avait préparé un copieux petit déjeuner avec, outre les habituels confitures et brioches, quelques spécialités locales dont je me languissais déjà: des « smörgas », les fameuses tartines de pain, accompagnées ici de tranches de saumon recouvertes d’aneth, des oeufs brouillés, et enfin des « bullars », c’est à dire des pâtisseries à base d’orange et de cannelle.
Je regrettai de ne pouvoir échanger comme elle ne parlait d’autre langue que le suédois, mais je la voyais de toute manière bien occupée par ses deux jeunes enfants, sans compter sur la sonnette qui retentissait parfois, annonçant l’entrée d’un client dans le magasin. J’avais d’abord pensé qu’il était fermé ce jour – on était après tout dimanche – mais comme beaucoup d’autres choses ici l’usage n’était pas de coutume.
Je terminai ainsi tranquillement mon petit déjeuner et quittai la table « rassasier jusqu’au soir au moins ». J’insistai pour faire la vaisselle, désireux de me mettre fin à cette sensation désagréable de m’être quelque peu imposé à mes hôtes mais la femme devait être encore plus têtue que moi comme elle m’assura par des gestes et sourire qu’elle s’en chargerait. Je quittai donc la maison « comme un voleur » pensai-je, sans avoir même eu le temps de remercier proprement Sven. Mon malaise s’atténua quelque peu sur le chemin du retour, songeant que les occasions ne manqueraient pas dans les jours à venir.
Il faisait particulièrement beau ce matin. Pour une raison que j’ignorais, la neige tombée la veille n’avait pas tenu; je ne remarquai pas d’augmentation de la taille des congères, ni même d’amoncellement particulier sur la route.
En approchant de la cabane, je fus saisi par un étrange malaise, quelque chose d’inexplicable, une sensation de picotement derrière la tête comme si quelque chose me perturbait au plus haut point sans que je parvienne à mettre le doigt dessus. La cabane se dressait pourtant toujours au sommet de sa butte, bien à l’écart de la route. Je m’engageai dans la petite cour au milieu de laquelle notre auto siégeait toujours. Je remarquai bien qu’Hélène l’avait entre temps déplacé de quelques mètres, sous un espace libre de la réserve de bois, craignant sans doute avec les bourrasques, et la tempête de neige de la veille qu’elle eut put être endommagé. Mais ce n’était pas ce qui m’avait perturbé un instant plus tôt. D’un pas vif je gravis la courte pente menant à la cabane. Les façades en bois me paraissaient plus claires que la veille, comme si on les avait lavées à l’eau, ou mieux: redonné un coup de jeunesse en passant nouvelle couche de peinture, mais sans doute n’était-ce là qu’un effet de mon imagination ou de la lumière ambiante. Je décidai, plutôt que de passer par la porte d’entrée, de faire le tour par la terrasse afin de surprendre Hélène.
En arrivant devant la longue baie vitrée un autre détail attira alors mon attention tandis que mon regard se perdait dans l’examen rapide d’une maison à oiseaux installée entre les branches d’un arbre voisin, j’aperçus une construction à laquelle je ne me souvenais pas avoir pris garde les fois précédentes. Bien que de dimensions égales à celles de la cabane, la maisonnette – serais-je tenté de l’appeler – semblait avoir jailli du sol pendant la nuit. Intrigué, j’oubliai temporairement la surprise que j’avais prévue de faire à Hélène et, risquai même de tout faire capoter lorsque grinçant à chacun de mes pas, je descendis l’escalier en bois qui menait de ce côté de la propriété. Je remarquai en me rapprochant de la cabane que celle-ci n’était en fait pas terminée. Un coup d’oeil par l’une des fenêtre me révéla une pièce unique et poussiéreuse au milieu de laquelle était entassée des sacs de ce qui semblait être du ciment – je n’en étais pas certain comme tout était écrit en suédois -, diverses planches de bois non vernies, ainsi qu’un grand nombre d’outils, pour la plupart de menuisier.
On aurait dit que quelqu’un avait soudainement abandonné un travail en cours.
« Ou prévoyait de revenir incessamment. » Pensai-je.
Mais la couche de poussière qui tapissait le sol dissipa bien vite cette dernière réflexion. Le propriétaire des lieux avaient du vouloir s’étendre, ajoutant un autre cabanon en plus de la réserve de bois, du sauna et du hangar à skis et moto-neiges. A quel usage destinait-il cette dernière construction ? C’était une question difficile, mais vue le soin porté à l’ensemble, notamment en terme d’isolation je supposai qu’il avait prévu que l’on y vive. Peut-être une cabane de jeu pour ses enfants, ou encore une retraite personnelle pour s’adonner à ses passe-temps: peinture, écriture, comment savoir ? Cette idée de retraite ne pouvait que m’amuser un peu, moi qui avais toujours vécu en métropole et considérai déjà notre cabane comme un refuge d’ermite.
Mon idée de surprendre Hélène me revint alors et je regagnai la terrasse à pas de loup, me frottant les mains d’avance. J’approchai la trentaine et pourtant ce genre de petite farce avait le même effet sur moi, un trait de caractère « grand-enfant » qu’elle ne manquait jamais de me rappeler. Je jetai un coup d’oeil discret par la grande baie vitrée et ce que j’y vis ne me fis qu’exulter davantage: lovée dans le canapé, je distinguai une forme assoupie. Ma montre m’informa qu’il était encore tôt donc cela ne me surprit pas davantage. La soirée de la veille avait dû la maintenir debout un certain temps, jusqu’à vingt-trois heures du moins, heure à laquelle nous avions fait sonner le cor. Connaissant Hélène, je savais que l’agitation que cela avait dû engendrer chez elle n’aurait pas manqué de la tenir debout une bonne heure encore après les faits.
Je m’approchai de la porte et fis doucement jouer sa poignée. Une légère résistance dans le mécanisme me laissa craindre l’espace d’un instant qu’elle l’eut fermé avant d’aller au lit, mais ce ne fut sans doute qu’un effet de son manque d’utilisation, je forçai un peu plus et elle s’ouvrit sans mal. Je progressai ensuite à pas feutré jusqu’à la petite kitchenette. Mon idée était de préparer un « gros petit déjeuner » avant qu’elle ne se lève et lui faire ainsi la surprise. En passant à côté de la forme blottie, je remarquai qu’elle s’était entièrement enrobée sous une masse de couverture, ne laissant paraître un centimètre carré de peau. Peut-être avait-elle eu froid ? Je ne m’en formalisai pas comme je connaissais bien son habitude à s’enrouler ainsi sous la couette, ce qui lui avait d’ailleurs valu de ma part le surnom de « rouleau de printemps humain ».
J’ouvrai le gaz, y mis de l’eau à chauffer et cherchai l’endroit où elle avait pu ranger le café en grain, les filtres et le sucre, ce qui m’amena – connaissant une fois encore ses curieuses manies – à démarrer par les recoins les plus improbables du garde manger. Cela fait je sortis le pain et me mis en besogne d’en couper de belles tranches pour les tartiner de miel et confitures. Aucun bruit ne se faisait entendre dans la pièce principale, Hélène n’avait pas bougé le petit doigt depuis mon arrivée. Je jetai un oeil à la forme sur le canapé et l’espace d’une seconde j’eus la pensée étrange que cela pouvait ne pas être Hélène mais juste un amas de couvertures gisant sur le canapé.
Mais dans ce cas où pouvait-elle être ?
Je n’avais vu personne dans le « jardin ».
Sortie faire un tour dans ce cas ? À cette heure ? Cela me semblait difficilement envisageable.
Elle avait disparu.
Cette pensée me saisit d’un coup comme une poigne invisible enserrant ma gorge.
Mon regard se perdit dans le vide en même temps que je fouillai des yeux le reste de la pièce, à la recherche d’un être désincarné. Le canapé n’était pas à la même place que je l’avais laissé la veille. Il se tenait à présent dos à la baie vitrée. Hélène l’aurait sans doute déplacé pour profiter un peu plus encore des rayons du ciel. Cela avait dû lui donner de la peine. C’était un lourd canapé d’angle en cuir après tout. Je ne me souvenais d’ailleurs pas non plus de cette matière. Celui que j’avais quitté hier était un simple canapé en tissu. Il portait encore la trace de notre passage: deux renfoncements creusés l’un à côté de l’autre, comme si un couple invisible s’y tenait encore, assis pour l’éternité.
Je me perdis dans la contemplation de cette image jusqu’à ce que le bouillonnement de l’eau que j’avais mis sur le gaz me ramena à la réalité. Au même moment j’entendis un léger frottement dans la pièce principale et me retournai pour découvrir la tête d’Hélène, encore marquée par le sommeil, émerger de l’amas de couvertures en laine. Elle me jeta d’abord ce regard chargé de stupéfaction, étranger au monde et aux individus, qui imprègne toujours une fraction de secondes durant, l’être qui se réveille. Durant ce bref instant nous redevînmes l’un et l’autre de parfaits étrangers. Je lui adressai un signe de la tête. Elle m’observa avec de grands yeux largement ouverts. L’instant passa sur la pièce comme une ombre fugitive au soleil et elle me sourit alors seulement puis referma les yeux en roulant sur le côté, à la recherche des dernières bribes d’un sommeil déserté. Je la laissai prendre son temps et versai le café dans deux tasses que je disposai comme il faut sur un plateau, juste à côté des tartines. J’y déposai quelques fruits secs achetés comme tout le reste chez Sven et emportai le tout sur la table basse voisine de son lit de fortune. Le café était encore trop chaud pour être bu donc je commençai, contrairement à mon habitude, par les tartines et le jus de fruit. Hélène me rejoint après une minute ou deux à errer entre éveil et somnolence.
« Tu as bien dormi ? » Lui demandai-je après qu’elle eut entamé sa deuxième tartine.
Elle acquiesça en haussant les sourcils avec exagération.
― Comme un bébé.
― Après les péripéties de la veille rien de bien étonnant. »
Elle m’observa un instant d’un air vaguement interdit puis finit par acquiescer de nouveau. Son hésitation m’étonna mais je la mis sur le compte du réveil encore tout frais.
― Tu n’as pas veillé trop tard hier ? » Dis-je en prenant soin d’accentuer les intonations ironiques.
De nouveau elle m’observa sans comprendre et répondit avec un premier degré qui me déconcerta un peu plus encore.
― Pas du tout.
― Pas du tout répétai-je », sans me dépareiller du sourire pendant à mes lèvres tel un masque.
― Je tombais tellement de sommeil que je n’ai pas eu le courage de t’attendre. Je me suis effondré presque aussitôt après que tu sois parti. »
J’acquiesçai vigoureusement, comme pour donner un sens, une réalité à ses mots. Elle poursuivit, buvant son café à courts traits.
« … Je m’en veux un peu, c’était imprudent de te laisser partir ainsi sans m’assurer que tu sois bien rentré. »
Je continuai d’acquiescer, à présent comme un automate. Mon sourire se transforma en une grimace figée au milieu du visage et devint aussi visible qu’une balafre. Je l’étirai aux limites de l’élasticité de ma chair, comme pour mieux me prémunir de l’effet de ses mots.
― Mais le signal sonore d’hier soir ? » Lâchai-je enfin tout bas en un souffle.
Elle m’observa sans dire un mot. Je n’étais plus stupéfait de ne lire dans son regard aucune trace d’humour ou de malice. Je retins mon souffle, me préparant à ce que j’avais en fait commencé à entrevoir sans m’y résoudre depuis le début de notre conversation.
Son sourcil gauche, si fin et délicat s’éleva sur son front et enfin, elle prit la parole, ses mots retombant comme un innocent mais aussi irrévocable verdict.
« De quel signal est-ce que tu parles ? »
*
Je n’ai jamais dit à Hélène de quel signal sonore est-ce que je parlais. Je crois me souvenir avoir prétexté sur l’instant m’être mal fait comprendre et ainsi porté la discussion à son terme. Sans doute m’avait-il semblé inutile d’ajouter au malaise que nous traversions alors et, rétrospectivement, je pense que cela fut le bon choix.
Cet après-midi là, nous décidâmes, suivant les conseils de Sven, de marcher en direction de Kiruna dans l’espoir de capter un peu de réseau et prévenir le loueur de notre infortune. Nous nous mîmes en route après un repas frugal, le petit déjeuner ayant été copieux, et une fois encore rejoignîmes la longue route qui se perdait à l’horizon.
C’était une bien étrange situation que de la remonter ainsi: sans objectif réel, ou en tout cas plus affirmé que celui d’attendre qu’il ne se produise quelque chose. Je ne partageai pas cette réflexion avec Hélène mais à l’air las qu’elle essayait de dissimuler par des sourires, je devinai que ses pensées ne devaient être bien éloignées des miennes.
Au moins nous voyions du paysage – pas vraiment inconnu certes ; Les mêmes montagnes se dessinaient au loin, cette fois sur notre droite, comme nous remontions la route dans l’autre sens, le ciel était parfaitement dégagé donc l’on pouvait bien voir la démarcation entre leur faîte et son bleu aigue-marine qui se dégradait progressivement dans l’azur, et à gauche, la forêt se faisait plus dense, le terrain remontait en pente douce mais ferme sur une distance indéterminable mais qui semblait se perdre dans l’air. Nous jetions régulièrement un oeil sur nos téléphones – j’avais entre temps rechargé le mien sur l’allume-cigare de l’auto, -mais l’indicateur de réseau n’affichait pour le moment qu’une petite croix rouge.
Je me retournai pour jeter un oeil à la distance parcourue et il me sembla que nous avions pu marcher une heure comme une journée. La cabane n’était plus qu’un petit point à l’horizon et le village n’était même plus visible. Nous n’avions croisé aucune voiture ni aucun élan depuis notre départ et plus que jamais j’eus la sensation d’être seul au monde, marchant le long d’une route criblée de trous – je m’en rendais à présent compte comme nous l’arpentions de plein jour – mais seule évocation du passage de l’homme dans ce coin du monde.
Une léger carillon se fit alors entendre et Hélène jeta un oeil à son téléphone.
― Tiens, il vient de capter quelque chose, j’ai une barre de réseau ».
Un instant après ce fut au tour du mien de donner de la voix.
― Pareil ici ! » Lançai-je.
Je remarquai néanmoins que la réception était encore instable comme la croix rouge apparaissait et disparaissait par intervalles rapprochés.
― On ferait mieux de s’avancer un peu plus pour être sûr que cela ne coupe pas pendant l’appel. »
― Surtout que l’on risque de passer un certain temps dans la file d’attente avant d’avoir quelqu’un ».
Nous marchâmes donc encore une paire de kilomètres et la réception parut s’être stabilisée comme nos appareils affichaient une barre pleine et ferme.
― Essayons avec le mien, il est plus récent ». Dit Hélène en me le tendant.
Je composai le numéro donné par le loueur en cas de soucis et patientai.
Alentour le paysage ne semblait avoir évolué depuis notre départ. Il se tenait figé aux abords de la route, seul point mobile filant comme un carrousel et j’eus la sensation d’avoir fait du sur-place depuis le début de notre marche. La cabane pourtant n’était plus visible.
La tonalité de l’appareil se prolongea et Hélène posa la main sur mon épaule, la mine déconfite.
― J’y pense: nous ne sommes pas dimanche au moins ?! »
Je marquai une pause, la tonalité bourdonnant toujours à l’oreille. On pouvait en effet bien être dimanche. J’essayai de me remémorer la dernière date positivement certaine, le dernier point d’ancrage temporel sûr. Nous étions arrivés en Suède un lundi, depuis il y avait eu le long voyage en train depuis Stockholm jusqu’à Umea, une journée, puis la longue traversée en voiture jusqu’à Storforsen, une journée, puis la remontée vers Kiruna, deux jours ? Trois jours ? C’était difficile à dire, tant cela me paraissait loin. On pouvait en tout cas bien être dimanche en effet.
J’étais sur le point de me lancer dans un autre décompte lorsque j’entendis un crachotement dans le téléphone, suivi d’une voix qui me répondit en Suédois.
Pris au dépourvu, je marmonnai quelques mots incompréhensibles avant de me reprendre en anglais, indiquant que je ne parlais pas la langue.
J’entendis un « Okay » incertain puis l’on me mit en attente.
Hélène m’interrogea du regard et je mis le téléphone sur haut-parleur. Une mélodie s’éleva dans l’air. C’était un morceau de classique, le genre connu mais dont on ne se souvient jamais du compositeur. Les violons vibraient dans l’atmosphère comme la bande-originale pas très innovante d’un film dramatique.
Au bout d’une minute ou deux elle s’interrompit en plein milieu d’une envolée lyrique et une nouvelle voix se fit entendre, parlant cette fois l’anglais.
« Umea location, que puis-je pour vous ? »
― Hmm… Oui, commençai-je dans un anglais hésitant, je m’appelle Mr Vesper, j’ai loué une voiture chez vous et nous avons un petit problème avec… »
Bref, j’expliquai mon problème avec le plus de détails possibles et tâchai de ne rien omettre. Cela prit quelques minutes, laps de temps durant lequel la voix à l’autre bout du fil ne m’interrompit pas une seule fois à tel point qu’arrivé au terme de mon explication, je me demandai si la communication n’avait pas coupé.
― Allo ? » Lançai-je après un long silence.
Je jetai un oeil à Hélène qui pendant ce temps était en train de jeter un oeil au contrat que nous avions signé à l’agence.
La voix revint:
« Quel est votre nom ? » Dit-elle d’un ton monocorde qui me fit suspecter qu’il s’agisse d’un robot serveur vocal.
― Vesper. V comme Victor, E comme Emmanuel, S comme Sébastien, P comme… »
« Je vous ai compris » m’interrompit-elle avec une pointe d’irritation, signe que cela ne devait finalement pas en être un. (Un bruit de pianotage frénétique se fit d’ailleurs entendre tout de suite après).
Hélène se pencha au même moment pour me souffler:
― J’espère que cette route n’est pas considérée comme un chemin « hors itinéraire de circulation », parce que nous ne sommes pas censés pouvoir l’emprunter. »
― Qu’est-ce que ça veut dire ? » Dis-je en bouchant le combiné du téléphone avec ma main.
― Il y a une close dans notre contrat qui parle des chemins de « terre ou de cailloux ».
Je repensai au chemin que nous avions emprunté quelques jours plus tôt pour nous rendre dans la petite église perdue et me félicitai de ne pas avoir crevé à cet endroit.
― Je ne pense pas que ça soit le cas, dis-je après une courte réflexion. De toute manière je me vois mal leur dire que nous sommes à Kiruna et pousser la voiture jusque là bas. »
― Tu ne m’as pas dit que ton nouvel ami Sven avait proposé de nous ramener des pneus neufs de la ville ? »
― Et bien ? »
― Et bien s’il est prêt à faire ça je ne vois pas ce qui pourrait le déranger de nous remorquer jusque là bas. Tu as dit qu’ils avaient tous des gros 4*4, ça ne devrait pas être un problème. »
Effectivement c’était une idée. Mais d’un autre côté – et sans que je ne sache trop pourquoi – elle me dérangeait un peu. Disons que je me voyais mal demander à Sven de me rendre un service frisant les limites de la légalité. Je n’étais certes pas obligé de tout lui dire mais tout de même: ma demande risquait fortement de l’intriguer et je n’avais aucune envie d’être contraint de lui mentir après toute l’aide qu’il nous avait apportée.
La voix au bout du fil revint alors:
« Mr Vesper ? »
― Oui ? »
« Quand avez-vous effectué votre réservation de véhicule ? »
― Cela devait être il y a environ une semaine, un peu moins sans doute… (Hélène me tendit un papier et pointa du doigt une date). Attendez, c’était il y a… une semaine en fait. J’ai le papier sous les yeux. »
― Une semaine… répéta la voix d’un ton qui me parut être de mauvais augure à ses accents d’incrédulité. (Nouveaux pianotages frénétiques).
Hélène me jeta un regard interrogateur et je ne pus qu’hausser les épaules.
Nous attendîmes un bon moment ainsi, le silence entrecoupé de plusieurs voix à l’autre bout du fil – car la première semblait en avoir appelé d’autres -, et du son de touches de claviers. Tout cela ne présageait rien de bon et n’y tenant plus je demandai:
― Il y a un problème ? »
La voix semblait à présent embarrassée:
« Mr Vesper, êtes-vous déjà venu en Suède ? »
Un peu étonné de la demande je pris un instant pour réfléchir, mais non je n’étais jamais venu.
« … Je vous demande cela car je n’ai aucune réservation à votre nom il y six jours… »
Ce fut à mon tour d’être passablement agacé:
― Bon et bien il y a pu avoir une erreur dans le contrat, peut-être que c’était un peu peu avant ou un peu après. Est-ce que vous pouvez jeter un oeil là dessus ? »
Sa gêne s’accentua:
― Je me suis mal exprimée: nous n’avons aucune réservation à votre nom tout court. »
Je marquai un silence.
« … La raison pour laquelle je vous ai demandé si vous étiez venu en Suède auparavant est que nous avons bien un Mr Vesper enregistré dans notre base mais que la location s’est effectuée il y a des années. Puisque vous me dites que vous n’êtes jamais venu cela doit être une autre personne. »
Je déglutis.
― Par curiosité, est-ce que vous pouvez me dire la marque du véhicule loué à l’époque ? » Demandai-je.
La voix marqua une pause et j’entendis un bruit de pianotage.
« D’après ce que j’ai dans la base c’était une Škoda modèle Octavia. »
Je me tournai vers Hélène qui s’était entre temps éloigné pour observer quelque détail d’un arbre au bord de la route et – sans savoir pourquoi – désactivai le mode haut-parleur du téléphone.
― Bien… (Ma voix se fit plus faible, comme un murmure qui ne veut pas sortir ou être entendu.) Et quel était le prénom de ce Monsieur Vesper que vous avez dans votre base ? »
J’observai Hélène qui portait la main aux branches de l’arbre, sans doute pour attraper quelque chose. Elle dut sentir mon regard comme je la vis se tourner vers moi et me lancer un: « Alors ? »
Je haussai les épaules en mimant une grimace et elle reporta son attention sur l’arbre.
« Monsieur Vesper ? Reprit alors la voix dans le téléphone.
― Oui ? »
« Le prénom de la personne est Syd… Est-ce une relation familiale ? … Monsieur Vesper ? Vous êtes toujours là ? »
*
― Comment est-il possible qu’il n’ait aucune réservation à notre nom ? » Me demanda Hélène sur le chemin du retour après que je lui ai fait un rapport de la conversation téléphonique que je venais d’avoir – ou du moins une partie-.
― Je n’en ai aucune idée L’. Peut-être un problème informatique ? »
― Tant bien même que cela soit une erreur de leur part lorsque nous avons rempli les documents à Umea. Ils doivent bien se rendre compte qu’il leur manque une voiture, non ? »
Je secouai la tête sans savoir quoi ajouter.
― Tu as raison, je n’en sais pas plus que toi, c’est incompréhensible.
― Si je résume ils n’ont aucune trace de ce véhicule que nous avons loué ? Donc nous pouvons le garder et en faire ce que bon nous semble ? »
― Je ne m’avancerai pas trop là-dessus. Les choses vont probablement rentrer dans l’ordre et je ne voudrai pas avoir de problèmes avec l’agence lorsque ça sera le cas. »
Nous nous perdîmes chacun dans nos pensées le reste du chemin qu’il restait à parcourir jusqu’à la maison.
Le lecteur se demandera sans doute pourquoi je ne parlai pas à Hélène des détails que m’avaient donné l’opératrice à la fin de notre conversation. Moi-même comme beaucoup de choses durant les derniers jours écoulés, je ne parvins à me l’expliquer convenablement, pour dire la vérité je ne voyais aucune raison valable si ce n’est que l’étrange climat dans lequel nous baignions depuis notre arrivée à la cabane risquait de se faire encore plus ressentir et je ne souhaitai pas la perturber davantage.
Bientôt la cabane se dessina entre les arbres, perchée sur sa petite colline. Je ne m’étais jamais rendu compte que l’on pouvait la voir de si loin – notre arrivée de nuit sous l’orage et les giboulées ayant dû perturber ma vision initiale de l’endroit de bien des façons.
― Qu’est-ce que l’on va faire du coup ? » Me demanda soudain Hélène, quittant son mutisme.
J’inspirai une bouffée d’air frais.
― Eh bien je suppose que je vais accepter la proposition de Sven de nous ramener des pneus neufs la prochaine fois qu’il ira à Kiruna. »
― Pourquoi ne pas lui demander tout simplement de nous ramener là bas pour notre avion ? »
Je soupirai d’exaspération.
― L’ on ne va pas laisser la voiture en plan ici. (Je la vis croiser les bras sur sa poitrine, ce qui n’étais jamais bon signe et j’adoucis quelque peu le ton). « Je veux dire: à un moment ou un autre le loueur va réclamer cette voiture n’est-ce pas ?
― Et en partant de cette hypothèse tu suggères que nous avancions l’argent pour quatre pneus neufs qui vont nous servir à faire quoi… moins de cinquante kilomètres ? Argent que nous ne sommes pas sûr de revoir bien sûr. »
Je ne pouvais lui donner tort.
― Écoute », dis-je alors que nous parcourions les derniers mètres de la route avant d’atteindre la cabane. « Rentrons déjà, posons-nous un moment et ensuite je demanderai conseil à Sven. Il pourra sans doute nous… »
Je m’interrompis alors. Nous venions de faire un premier pas dans la petite cour précédent la cabane, là où se trouvait la réserve de bois, la remise à outils et… Je me tournai vers Hélène qui devait afficher sensiblement la même mine que moi: stupéfaite et interloquée.
Nous restâmes ainsi une dizaine de secondes sans réagir. Non. En fait je ne sais combien de temps. Je n’en ai aucune idée, cela aurait aussi bien pu être une minute. Elle fut la première à rompre le silence:
« Bien… »
Et moi de reprendre, comme si le son de sa voix m’avait ramené à la vie. Une existence faible et vacillante mais qui demeure:
« Cela résout le problème… »
Au milieu de la cour, là où se tenait – et s’était tenue – depuis notre arrivée la voiture de location, ne restait à présent qu’un grand vide. De la terre recouverte par la neige. Pas une empreinte de pneu, ni une trace noir laissée par le souffle du pot d’échappement dans les flocons. Rien qui puisse témoigner de son existence ou même de son passage dans ce coin perdu du monde.
Rien du tout.
Je n’osai à présent croiser le regard d’Hélène; il ne m’était pas difficile de l’imaginer. Je restai là, le regard planté dans le néant, comme si quelque chose devait soudain en jaillir. Mais tout restait immobile, à tel point que l’on aurait pu croire le temps suspendu, figé dans une seule image bouclée sur elle même, comme si le paysage avait interrompu sa respiration, et le vent d’aller et venir sur les crêtes enneigées.
J’entendis un reniflement et je compris qu’Hélène était en train de pleurer. Je ne me retournai point. Ma conscience me hurlait de le faire et la prendre dans mes bras, mais je n’en fis rien. C’était la chose la plus évidente du monde, la plus évidente et la plus simple mais je n’en fis rien. Tout ce que j’avais à faire c’était me tourner vers elle et la prendre dans mes bras, alors pourquoi était-ce si difficile ?
Le silence vertigineux, blanc et parfait qui englobait ces terres était à présent ponctué par des reniflements et sanglots étouffés.
Toujours sans un regard ni une parole, je m’avançai au milieu de la cour; me voici sur la scène d’un crime non advenu, ou au contraire rendu caduc par le temps. Peut-être était-ce la nervosité, ou encore une nouvelle façon de me désolidariser de la réaction d’Hélène, mais cette pensée enracina un maigre sourire sur mon visage. Je n’étais alors pas loin de me détester, j’aurais voulu être quelqu’un d’autre, ou en tout cas quelque chose de mieux. Le pire était de savoir quoi faire mais ne pas s’y employer. Pourquoi était-ce si simple et en même temps impénétrable ? Les larmes me vinrent et j’entrepris de remonter la petite cote jusqu’à la cabane. Au fond je remarquai à peine l’autre construction: elle semblait désormais presque achevée, et une cheminée en tôle avait même jailli de sa toiture. Je l’ai dit: je n’y prêtai pas d’attention particulière et marchai d’un pas sûr, bien que sans but précis, jusqu’à la porte de la cabane. Un mètre ou deux avant le seuil je m’interrompis comme quelque chose me perturba. Je levai les yeux et aperçus un post-it de couleur jaune collé sur le bois du battant. Machinalement, je m’en saisis et le parcourus d’un oeil indifférent, sourd que j’étais devenu, à toute nouveauté, insensible à toute surprise ou détail un tant soit peut extraordinaire. Dans mon dos j’entendis le pas d’Hélène. J’attendis encore un peu avant de lui faire face enfin. Des papillons de nuit s’étaient glissés en lieu et place de ses cils, déployant leurs ailes cendrées aux abords de ses joues. Ils me toisaient. Ses yeux rougis, eux, n’exprimaient que le plus haut sentiment. Nous demeurâmes ainsi un bref instant. Je n’osai point bouger, stupéfié que j’étais par mon propre immobilisme, et l’apathie qui me rongeait. Ce fut elle qui, une fois encore, vint rompre le malheur.
« Qu’est-ce que c’est ? » Me demanda-t-elle d’une voix chevrotante.
Je quittai ma léthargie et jetai un autre coup d’oeil au post-it, comme si je n’étais pas bien sûr. Il n’y était pourtant écrit qu’une seule phrase:
― Fête au village », lis-je tout haut. Venez ! »
Je marquai une pause:
« … Il y a aussi un double point et une parenthèse. »
Hélène se pencha sur le papier.
― C’est un smiley. » Dit-elle finalement sans en détacher les yeux.
Je l’examinai à mon tour. C’en était bien un. Pourquoi ne m’en étais-je pas aperçu ? Ce n’était jamais que deux caractères associés l’un à l’autre.
― Que fait-on ? » Me demanda-t-elle.
Je n’étais pas bien sûr de la bonne réponse, ni même s’il en existait une. Les mots quittèrent mes lèvres sans même que je les ai formulés au préalable dans mon esprit, une pure réponse spontanée:
― Nous irons au village ce soir, quelqu’un doit bien savoir quelque chose… »
Hélène me répliqua alors exactement que j’avais craint, au moment même où je m’étais entendu la prononcer:
― Savoir quoi ? »
Et cette fois je n’eus que le silence à offrir comme seule réponse.
*
Une fois encore je suis sur la route. Elle pointe jusqu’au village où sa perspective est interrompue par les maisons. Je ne parviens à me souvenir du nombre de fois que j’ai fait ce trajet. J’essaye de les compter dans ma tête, pour passer le temps. Le matin suivant l’arrivée pour les provisions, le retour pour ramener la moto-neige. Puis une autre fois pour je ne sais plus quelle raison, le retour… Je perds le fil à cet endroit, y suis-je retourné une autre fois ? Deux ? Impossible de m’en souvenir. Hélène m’accompagne. C’est sa première fois au village. Où bien est-elle déjà venue ? Non. Je ne sais plus très bien… Elle marche à mes côtés sans dire un mot. Je sais qu’elle est préoccupée. Sans doute encore par cette histoire de voiture. Je cherche à tracer une chronologie des évènements, mais tout me paraît lointain et mes souvenirs distants les uns des autres. Mon esprit se heurte à un mur blanc. Cette éternelle chaîne de montagne qui se dresse à l’horizon. J’aperçois déjà le village, confortablement niché dans son écrin de sapins au vert sombre et je réalise que nous ne devons plus être très loin de la fin du voyage. Je réfléchis bien mais je n’arrive pas à me rappeler non plus du nombre de jours que nous avons réservé la cabane et depuis combien de temps est-ce que nous sommes là. Je songe à consulter Hélène mais d’après cet air absent qui s’est diffusé sur ses traits, je devine que sa confusion doit être égale à la mienne. Elle me pointe du doigt les lumières illuminant les maisons. Quelques guirlandes ont été dressées ça et là, en travers de l’unique rue. J’y devine une certaine animation, de nombreuses silhouettes l’arpentent en tous les cas.
Lorsque nous arrivons, les silhouettes sont devenues des personnes, des visages que je ne reconnais point mais qui pourtant me sourient, m’adressent des signes de la main comme si nous étions de vieilles connaissances. Hélène doit être ici pour la première fois: elle est sortie de sa réserve et observe chaque détail du village avec curiosité. Alentour, les gens vont et viennent, entrent et sortent des maisons, s’abordent dans la rue pour engager des conversations dont je ne peux saisir un mot, non seulement parce qu’ils sont en suédois, mais aussi parce qu’ils règnent une étonnante cacophonie, j’ai comme perdu l’habitude de toute cette agitation. Je suis mal à l’aise et je vois bien qu’Hélène partage ce sentiment malgré ces tentatives de faire comme si de rien n’était, me désignant d’un signe de tête telle ou telle curiosité locale. Nous sommes comme deux bonhommes de neige plantés là en plein été et l’éclat du soleil nous ronge. Il fait encore jour. Les silhouettes semblent se multiplier. Je juge que cela doit être mon imagination et la fatigue. Les mêmes personnes que je vois passer puis repasser devant moi en une boucle infinie: il ne peut y avoir autant d’âmes dans un si petit village. Et les figures inconnues continuent de nous lancer des sourires, des signes de tête entendus.
Au loin j’entends mon nom:
« Syd ? »
Je me retourne une première fois. Ce doit être la mauvaise direction comme je n’y trouve personne s’adressant à moi.
« Vesper ! Houhou ! Par ici »
J’essaye l’autre côté et j’aperçois une silhouette qui me fait signe, pas très loin. Je ne la reconnais pas donc je m’approche pour mieux voir. C’est un homme de belle taille. Il est d’un certain âge déjà, ses cheveux, jadis blonds tutoient à présent le gris et une épaisse barbe recouvre son visage. À côté de lui il y a une femme, peut-être un peu plus jeune mais à peine, et deux jeunes hommes dans la vingtaine. Je devine que cela doit être sa famille. Je continue de m’avancer à petits pas mais l’inconnu me devance et avant que j’ai pu faire quoi que ce soit est à ma hauteur et m’assène une tape dans le dos.
― Content que tu sois venu mon vieux. »
Ses yeux plongent sur Hélène.
«… Avec Madame je vois… Ce n’est pas souvent que l’on vous voit descendre au village Hélène… »
Je concentre mon regard sur l’inconnu et m’efforce de décrypter l’expression de son visage, à forcer l’énigme de ses traits et lorsqu’enfin la réponse illumine mon cerveau comme la flamme d’un briquet crépitant dans le noir, mes lèvres ne peuvent retenir l’expression de ma stupéfaction:
― Sven ! »
Il se tourne dans ma direction et a l’air attendre la suite d’une phrase jamais composés. J’essaye de reprendre mes esprits mais je suis presque sûr qu’il a remarqué mon air ahuri. Je lui lance:
« … Cela me fait plaisir de te voir. »
Sa barbe se contracte et je devine un sourire malicieux.
― À la fête du village ? Le contraire aurait été étonnant si tu veux mon avis. Ce n’est pas comme si l’on avait pas fait rapidement le tour… »
J’entends Hélène qui s’esclaffe, mais il y a quelque chose de dissonant dans son rire. C’est davantage une réaction nerveuse que toute autre chose.
― Ce n’est pas souvent que l’on vous voit descendre au village » a-t-il lancé…
À moins que cela ne soit une sorte de vanne ? Je n’ai pas le temps d’approfondir cette pensée comme il nous entraîne aussitôt à sa suite dans la rue principale. Alentour je crois reconnaître des visages déjà entraperçus, mais quelque chose me perturbe. La réalité qui nous entoure semble distordue, incomplète, comme un miroir fêlé ne reflétant que par bribes l’image qu’on y appose. Tous ces visages me sont familiers mais aussi inexplicablement plus marqués par le temps, plus… vieux ? Ceux que j’avais connus enfant sont maintenant de jeunes adultes. J’en vois passer tout un groupe, parmi eux une jeune fille aux longs cheveux roux. Leur couleur s’est ternie et tire à présent vers le blond pâle. Je songe à la fillette aperçue quelques jours plus tôt un jour dans la rue, jouant à faire un bonhomme de neige avec sa mère. Lorsque mon regard se pose sur la paire de boucles d’oreilles qu’elle porte, qui s’agite à son passage et celui de ses amis – de jeunes garçons principalement -, je détourne aussitôt les yeux.
Une voix claire et musicale vint alors ponctuer l’harmonie de cette tranquille agitation qui nous entoure.
« Bonjour Mr Vesper »
Je me tourne, feignant la surprise, mais je sais déjà d’où viennent ces mots. La jeune fille et ses amis se sont arrêtés dans leur élan, à quelques mètres, et me saluent d’un geste de la main avec de grands sourires sur le visage. Sans même y penser je leur adresse un clin d’oeil et leur course reprend comme si rien n’était jamais venu l’interrompre.
« Toujours aussi populaire ? » Me souffle Sven à l’oreille.
Je réprime un sursaut comme sa présence m’avait presque échappé.
« … Je me souviens du temps où vous craigniez ne pas vous fondre dans le moule. »
Je lui réponds par un sourire gêné. Je veux dire: j’essaye de lui donner du naturel, mais je ne suis pas certain du résultat et je préfère être honnête.
Une légère brise arpente la rue et fait virevolter sur son passage les quelques guirlandes et bannières qui ont été accrochées pour l’occasion.
Quelque chose me paraît anormal. La lumière est plus basse qu’à l’accoutumée. On dirait presque que la nuit est sur le point de reprendre ses droits. Je remarque que Hélène a l’air tout aussi perturbé.
Les garçons de Sven, deux solides gaillards d’une petite vingtaine d’années, m’observent d’un oeil curieux. Je fuis leurs regards scrutateurs et fais mine de rien en plaisantant sur le costume de renne d’une petite fille qui – sans doute trop jeune pour sortir si tard – passe la tête par l’entrebâillement d’une fenêtre et nous adresse de grands signes de la main.
― La fille de Hilda a bien grandi… » Souffle Sven en lui répondant par une série de grimaces des plus comiques. Cela provoque l’hilarité de sa jeune spectatrice. Elle se cache derrière l’épais rideau en laine et l’on ne voit plus que ses petits poings tenant fermement la tenture.
« Les autres commencent à rentrer… »
À l’entour en effet, la petite foule échange des embrassades, des poignées de mains et commence à se disperser vers leurs foyers respectifs.
« Allons prendre un verre à la maison, venez ! » Nous invite Sven d’un ton sans équivoque. Nous échangeons un regard avec Hélène mais déjà la petite tribu s’est détournée, prenant le chemin de sa maison, Sven en tête.
Je souris.
Jamais aurait-il pu imaginer une seule seconde essuyer un refus de notre part.
Nous le suivons sans dire un mot.
*
« Allez, bonne fin de soirée à vous deux. »
Lorsqu’après plusieurs verres du whisky local, nous quittons enfin la maison, mon regard se perd dans le noir, il fait sombre, la nuit s’est abattue et son voile obscur englobe à présent le village, les forêts et montagnes.
Avec Hélène nous échangeons un regard blanc. Sven qui nous a raccompagné jusque sur le palier se tient derrière.
― Qu’est-ce qu’il fait sombre. » Finit par lacher Hélène.
Celui-ci ne semble pas bien saisir le sens de sa phrase mais lui répond tout de même:
― C’est l’hiver, le soleil se couche très tôt dans cette région… Vous ne vous y êtes pas encore accoutumés ? »
Nous haussons les épaules après une brève hésitation.
― Je crois que j’ai oublié de prendre une lampe torche. »
Sven fronce les sourcils.
― Et ça qu’est ce que c’est ? » Me lance-t-il en désignant quelque chose.
Je baisse les yeux vers une poche de mon manteau d’où dépasse… une lampe torche.
― Tu es sûr que ça va Syd ? Tu m’as semblé un peu… à côté de tes pompes ce soir ? Tu es fatigué ? » Dit-il en riant.
J’acquiesce en secouant la tête.
― C’est cela, nous allons nous coucher, la journée a été longue. »
― Faites attention en rentrant, allumez bien vos phares, il y a des rennes qui se baladent sur la route de nuit. »
Je ne comprends pas tout de suite de quoi il parle, ce n’est qu’après nous être enfoncés un peu plus dans la nuit, au delà de l’aura lumineuse dégagée par la maison que je saisis.
Face à nous, garée à côté du portail d’accès à la maison se trouve une moto-neige. J’échange un coup d’oeil avec Hélène. Je porte la main à ma « poche habituelle » – celle de droite sur mon jean – celle où j’ai toujours eu l’habitude de mettre les « choses importantes ». Sans surprise mes doigts rencontrent un bout de métal froid. Je le tire de ma poche et cela fait un bruit clinquant. Des clés. Je les glisse dans le contact de la moto-neige et la démarre sans difficulté. Je l’enjambe, les commandes, la posture, tout me semble familier. Hélène m’observe toujours, incrédule et je lui fais signe de tête, ce qui semble rompre le sortilège de stupéfaction dont elle est victime.
« Allez on rentre » lui dis-je d’une voix éteinte.
*
Les phares de la moto-neige déchire le voile obscur de la nuit en deux sillons parfaitement parallèles glissant sur le manteau de neige qui recouvre la route. J’aperçois de temps à autre leur faisceau se refléter dans les yeux de petits animaux à l’affut sur le bas-côté. Je me demande si Hélène qui se cramponne derrière moi les voit aussi. Je suis pressé de rentrer. Inexplicablement. Donc j’accélère, je tire plus fort sur la poignée, le moteur prend des tours et l’engin de la vitesse en un hurlement à demi étouffé par le carénage, et l’échappement.
À l’entour, les crêtes et troncs d’arbre se fondent, forment un ensemble, une peinture dont les couleurs couleraient les unes par dessus les autres.
Et de ce flou artistique mais cohérent jaillit une idée dans ma tête, tout cela en quelques secondes, comme ces films où l’on assiste à l’éclosion d’une fleur en accéléré. Je suis tellement fier de moi que j’accélère encore. Je n’ai plus qu’une hâte maintenant: mener cette idée à son terme. On ne devine même plus les silhouettes des arbres, tout se mélange, tout se transforme, plus rien ne se crée ou n’émerge de ce monde sauvage qui nous jonche et nous encercle infiniment.
D’un coup, au beau milieu de cet instant figé, je sens Hélène qui me tape sur l’épaule avec force. Je baisse les yeux sur la route. À une cinquantaine de mètres se dresse un renne. Il se tient, immobile au beau milieu de la voie, rompant sa perspective avec insolence, et j’observe sa pupille qui se dilate et s’agrandit alors que nous fonçons sur lui en un rugissement mécanique de bête cauchemardesque, avec la forêt pour royaume.
Et un bref instant, elle semble retenir son souffle.
L’animal semble me toiser d’un oeil de fer et lorsque j’arrive sur lui, je ne peux que donner un violent coup de guidon pour nous prévenir d’un accident. L’engin répond paresseusement en déviant d’un mètre sur sa trajectoire. J’ai l’impression de sentir le poil de l’animal effleurer ma peau. Je suis presque sûr de ne pas l’avoir touché. Nous fonçons vers les troncs d’arbres et je redonne un puissant coup dans le guidon, l’accompagnant de tout mon corps pour redresser l’engin. Celui-ci fait une embardée et parvint à se remettre sur sa trajectoire initiale. Tout s’est passé tellement vite que je n’ai même pas entendu la boîte automatique changer de rapport. Je ralentis et jette un oeil dans mon dos. Le renne n’est plus visible. La neige est rouge sang. C’est à cause du feu arrière. Je me sens soulagé. Hélène me tape violemment sur l’épaule et me crie dans l’oreille :
« Qu’est-ce qui t’as pris de rouler si vite ? »
Je ralentis aussitôt.
Le décor cesse de défiler; je distingue à nouveau les silhouettes des arbres. Elles se détachent d’un fond obscur où l’on ne peut que deviner la découpe des montagnes: des voiles blancs fantomatiques tendus au loin, des lames de fond qui approchent en silence.
Dans mon dos, Hélène sanglote. Je sens aussi que son étreinte autour de ma taille s’est resserrée. À moins que cela ne soit mon imagination ? Il fait si froid que je me demande s’il me reste encore quelque sensation tactile. Peut-être mon coeur a-t-il déjà gelé et que toutes ces impressions ne sont que des résidus sensoriels arpentant ma mémoire ? Comme un membre fantôme, amputé, mais que l’on éprouve toujours.
Au loin j’aperçois des lumières. Nous arrivons à la cabane.
Lorsque nous franchissons enfin l’ultime crête empruntée par la route, elles nous sautent aux yeux comme un fabuleux nuage luminescent auréolé de cercles opales et je devine la forme de la cabane, juchée sur son petit promontoire dominant les alentours.
Je cligne des yeux tandis que derrière, je sens la main d’Hélène qui lâche mon tour de taille pour se mettre en visière. Je ralentis encore un peu l’allure et longe le bas-côté comme je crains de manquer le passage d’accès à la cour…
Mais il y a un muret tout le long de la route, délimitant la propriété.
Je le suis jusqu’à atteindre un grand portail en bois massif. Il est fermé. À côté se tient une boîte à lettres perchée sur un piquet en bois. Il est écrit « Mme et Mr Vesper ». Je ne peux voir le visage de Hélène comme elle se trouve toujours derrière moi mais je sais qu’elle a vu la même chose que moi. Sans même en avoir conscience je fouille dans la poche droite de mon blouson (celle où j’ai l’habitude de ranger tout ce qui est « très important »). Je sens plusieurs choses, dont un gros trousseau de clef et ce qui pourrait être… une télécommande. Je l’extirpe. C’est un petit boîtier en plastique noir comportant deux boutons. J’en presse un. Des lumières s’allument mais je ne vois pas très bien lesquelles comme elles viennent de l’autre côté du portail. J’essaye le deuxième. Une sorte de « bip » se fait entendre, suivi d’un bruit de crémaillère mécanique et le portail commence à s’ouvrir. Nous ne soufflons mot. Les deux battants en bois se séparent, nous ouvrant la voie de la petite cour qui baigne désormais dans la lumière. Au beau milieu trône une automobile. Sans trop savoir pourquoi je ne suis pas surpris. Je remarque aussi le dépôt de bois sur la gauche, ce n’est plus un simple toit posé sur deux poteaux mais une véritable cabane. J’avance la moto-neige dans la cour et coupe le contact. Je descends et m’approche de la voiture. C’est un 4*4 flambant neuf. Rien à voir avec notre véhicule de location. J’entends le pas de Hélène qui se rapproche, elle me dépasse et m’effleure comme une ombre et se penche à sa vitre pour jeter un oeil à l’intérieur. Je fouille dans ma poche et en tire le trousseau de clés que j’avais senti un peu plus tôt. Je repère une grosse clef codée et appuie dessus. Une série de « bips » des plus élégants résonne en même temps que les phares de la voiture s’illuminent. Hélène sursaute et je continue de faire le tour tandis qu’elle fouille dans la boîte à gants.
― Ce n’est pas une voiture de location. » Dis-je à voix haute.
Et je l’entends me répondre:
― Non… » Elle me tend les papiers du véhicule. « C’est la notre. »
Mon regard remonte alors le long de la petite butte jusqu’à la « cabane » qui n’en a en fait plus rien d’une, et pour cause: devant nous se dresse une somptueuse propriété s’étirant sur deux étages. Les murs sont en bois massifs vernis d’une couleur sombre rappelant celle du teck. Elle est percée de nombreuses fenêtres recouverts de rideaux en dentelle à la mode d’antan mais d’un goût certain. La terrasse s’est agrandie et je crois distinguer un jacuzzi d’extérieur. À cette période de l’année nous l’avons cependant condamné et il est recouvert d’un genre de sarcophage en bois destiné à le prévenir des dégâts de l’hiver. Nous continuons notre ascension. Sur la droite il y a un petit talus, des marches qui s’enfoncent dans le sol et une lourde porte en bois gardant l’entrée d’une cave à vin. J’y entrepose plusieurs bouteilles de valeurs, le plus souvent offertes par des relations de travail. Parmi les pièces maîtresses il y a plusieurs magnums de Château Cheval Blanc 2009, un excellent millésime d’après moi.
Un peu plus loin il y a une autre cabane – celle-ci mérite bien l’appellation -, je m’en sers comme retraite artistique. C’est une petite pièce tout ce qu’il y a de plus simple; elle est chauffée à l’ancienne avec un poêle à bois. (j’ai récupéré celui-qui se trouvait originellement dans la maison principale, laquelle s’est bien sûr vue dotée entre temps de l’électricité, et tout ce que le confort moderne peut apporter.) Il y a un lourd bureau en bois massif et un confortable fauteuil en cuir avec armatures en fer forgé, le tout dans un esprit industriel rappelant le style des lofts new-yorkais des années quatre vingt.
C’est également ici que j’entrepose ma collection de vinyles. J’en ai plus de cinq cents – je les ai comptés durant une après-midi de désoeuvrement -. Hélène s’étonne toujours que je les laisse dans cette cabane, vide de toute présence quatre-vingt pour cent du temps, et froide comme une chambre frigorifique, mais j’ai lu dans un magasine que les basses températures étaient bonnes pour leur conservation.
Je ne l’ai pas précisé mais bien entendu j’ai refait faire toute la cour. Il y a maintenant un petit chemin en bois qui s’étire et s’étend comme une toile d’araignée, reliant entre elles toutes les installations de la propriété. On a disséminé ça et là de faux réverbères à bec de gaz, et je les aime car il me rappelle Paris. D’une manière générale on peut dire que la propriété baigne en permanence dans la lumière, l’été avec ce soleil qui ne se couche jamais, l’hiver grâce à l’électricité.
Le reste des changements n’est qu’une série de petites bricoles: j’ai fait sur-élever le sauna pour des raisons de sécurité dont j’ai oublié le motif, de même pour la rivière qui coulait un peu plus en bas de la propriété: je l’ai fait assainir pour éviter les soucis d’inondation à la fonte des neiges. (Je ne peux nier que c’était à regret comme j’affectionnais particulièrement d’entendre le grelot de son murmure chaque matin au petit déjeuner, mais la sécurité devrait toujours être prioritaire). Enfin, j’ai aussi fait couper deux sapins qui auraient pu présenter des risques de s’abattre sur le sauna et fait rabaisser le niveau d’une petite colline avoisinante par crainte de coulées de boue.
Le froid devient intenable donc je rentre me mettre au chaud dans la maison. Hélène est en train de lire un livre, lovée dans l’immense canapé d’angle en cuir épousant tout un coin du salon. Par la gigantesque baie vitrée j’observe au loin les montagnes, elles dorment sous l’aura pâle mais bienveillante de la lune qui les couve de son grand oeil vide et blanc. Le feu crépite dans le cheminée et de douces odeurs de pains s’échappent de l’âtre. Je me dirige vers le mini-bar, et me sers un fond de Lagavulin, seize ans d’âge. Rien de bien original mais j’apprécie toujours autant de sentir ses arômes tourbées se confondre avec les effluences du bois craquant dans le foyer. Je le porte à mes lèvres. Bonheur.
Je souris de satisfaction et rejoins finalement Hélène sur le canapé.
Nous arrivons à la fin de mon histoire, le dernier paragraphe, celui où vous vous attendriez sans doute à lire quelque chose comme:
« D’un coup je me réveillais en sursaut, trempé de sueur. À côté, dans le modeste lit de notre petit appartement dormait paisiblement Hélène etc… »
Et croyez bien que cette conclusion serait de mon point de vue aussi une fin opportune. Mais cela serait surtout mentir que de la terminer ainsi donc je me contenterai de dire que le temps a passé, fluide comme l’eau d’une rivière.
Il existe une région solitaire, perdue aux confins d’un pays retiré. Je l’ai vue de mes propres yeux. Là-bas, si loin au nord, se trouve une ville à la lumière immortelle: Kiruna.
La course de son astre s’est enrayée dans le ciel mais le temps, lui, a poursuivi la sienne sans même qu’on ne le soupçonne.
Pendant tout ce temps il demeurait, là, sous nos yeux largement fermés.
C’est vraiment tout ce que j’avais à dire.


Laisser un commentaire